Vue depuis le petit balcon de notre chambre.
La légende raconte que l'intérêt de ce site minier trouve son origine au début du 17ème siècle, lorsqu'un potier y aurait trouvé de l'or. Malheureusement pour lui le gouverneur de la région eut vent de cette histoire et envoya des hommes armés pour lui dérober la pépite et lui faire avouer où il l'avait trouvée. Le potier fut jeté en prison où il mourut, emportant son secret avec lui.
La zone minéralisée fut exploitée intensément de 1862 à 1867, puis dans une moindre importance, de 1867 à 1917, date à laquelle les travaux miniers sont définitivement arrêtés.
La mine a fourni, de 1862 à 1917, 40 000 tonnes de minerais d'une teneur de 3% de cuivre en moyenne soit environ 1200 tonnes de cuivre métal, et de 100 tonnes de plomb métal dont le minerai présentait une teneur de 7 à 8 % ; le plomb n'était signalé qu'épisodiquement, ce qui explique le faible tonnage produit.
Le 09 juillet 1994, le Musée de la mine de Cap Garonne est inauguré grâce à la mobilisation du syndicat intercommunal.
Nous marchons encore quelques dizaines de mètres au delà du musée pour découvrir un panorama exceptionnel sur la grande rade de Toulon. Face à nous, on aperçoit distinctement l'entrée de la petite rade barrée de nombreux ouvrages disposés pour empêcher une incursion à grande vitesse d'éventuels navires hostiles. Éric énumère les noms des Monts toulonnais qui se détachent parfaitement sur ce fond de ciel azuréen : Le Coudon, le Faron qui surplombe Toulon, le Baou de Quatre Aures, le Croupatier. (Le point culminant est le mont Caume qui culmine à 800 m. Mais il n'est pas visible depuis le site de la mine.)
Au tout premier plan, nous pouvons apercevoir la vaste maison du Préfet Maritime qui domine la rade. On distingue clairement la presqu'île de Saint Mandrier et plus au sud l'élévation de la falaise du Cap Sicié où se dresse 🔰Notre Dame du Mai, petite église célèbre pour la vue exceptionnelle qu'elle offre à la fois sur la rade de Toulon et sur la côte jusqu'aux calanques de Cassis.
Nous marquons un arrêt devant la petite Chapelle Notre Dame de Faron. C'est un sanctuaire bâti dans un ancien magasin à poudre. Éric nous conte, l'intéressante histoire de la petite statue de bois de la bonne mère qui constitue le principal mobilier de l'endroit : On doit cette œuvre à Gabriel Cotel, sculpteur hyérois. Sa 🔰statue en bois, image d’une jeune fille toute simple n'était pas d'inspiration religieuse. Louis-Valéry Roussel, créateur du téléphérique du Faron et promoteur du sanctuaire qui avait possédé la statue eut l'idée de l'installer dans le sanctuaire. Mais il fallait la récupérer auprès de Madame Icks à qui il l'avait généreusement offerte. Ce fut Jacky Icks, fils de la dame et pilote fameux, qui se chargea de convaincre sa mère du bien fondé de cette restitution. La "jeune fille" fut envoyée au Faron…
Malgré un 🔰petit pied dénudé, on lui mit une auréole de cuivre… Notre-Dame du Faron était née. Le sculpteur Cotel fut enchanté d’apprendre le sort final de sa "jeune fille".
L'ancien magasin à poudre faisait partie de l'important dispositif de défense installé stratégiquement sur le Mont Faron pour protéger Toulon. Éric évoque l'importance du site dans la carrière de Napoléon Bonaparte alors tout jeune capitaine. En 1793, dans le contexte révolutionnaire de la Terreur, les forces royalistes avaient repris la ville de Toulon et s'étaient coalisées avec les britanniques et les espagnols. La flotte anglo-espagnole occupait la rade.
Les troupes de la Convention sont dirigées par Dugommier, Lapoype et le jeune Bonaparte. Un assaut général est lancé dans la nuit du 16 au 17 décembre 1893. Le corps à corps dure toute la nuit, Bonaparte y est blessé d'un coup d'esponton à la cuisse par un sergent britannique, mais au matin, la position est prise ; les Britanniques évacuent sans combat. Les forts du Faron et de Malbousquet sont repris le jour même. Les Coalisés décident alors d'évacuer par la voie maritime. Le commodore Sidney Smith fait brûler une partie de la flotte et les stocks de bois de l'arsenal avant d'embarquer pour fuir. La répression est sanglante : on estime que 700 à 800 personnes sont fusillées sommairement, sur le champ de Mars. Le capitaine Napoléon sera directement promu au rang de Général de Brigade. Le 24 décembre 1793, la Convention vote un décret disposant que : « Le nom infâme de Toulon est supprimé. Cette commune portera désormais le nom de Port-la-Montagne ». Toulon retrouvera son nom plus tard sous l'Empire.
Nous voilà arrivés au "Point Sublime" où s'élève une haute croix en bois, "la Croix Radieuse". Le panorama qui s'y offre sur la ville et la rade est 'sublime' évidemment. On distingue parfaitement les navires de guerre amarrés dans la petite rade, quatre frégates, un ravitailleur, un porte-hélicoptère et le fameux porte-avion, le "Charles De Gaulle", seul bâtiment de surface français à propulsion nucléaire. Au delà, on distingue la presqu'île de Giens et les Îles d'Hyères. Nous nous dirigeons maintenant vers le 🔰Mémorial du Débarquement en Provence en empruntant un petit chemin plus au nord qui permet un point de vue sur le Mont Caume, le plus haut des monts toulonnais. Le Mémorial se dresse à l'emplacement de la tour Beaumont, petit fortin militaire qui était destiné à la surveillance du littoral. L'architecte Pierre Pascalet en a utilisé les locaux, y appuyant une série de bâtiments bas. L'ensemble fut inauguré le 15 août 1964 par le général de Gaulle. Le Mémorial a été rénové en 2014. La diversité des origines des combattants venus libérer la France – les soldats venus d'Afrique, les résistants et les alliés – aux côtés des Français libres et, par conséquent, la pluralité des mémoires du débarquement de Provence, sont mises en avant dans la nouvelle muséographie.Nous sommes à deux pas du téléphérique où s'allonge une joyeuse file d'attente pour rejoindre la ville basse et clore le très riche programme de cette première journée.
Aujourd'hui, rendez-vous nous est donné au sud de la presqu'Île de Giens, près la Tour Fondue à l'embarcadère pour Porquerolles, la plus étendue des Iles d'Hyères. Nous montons à bord du 🔰Méditerranée IX, une vedette de la compagnie TLV-TVM. Le soleil est généreux, la mer parfaitement calme dispute au ciel un azur des plus intenses.
Nous débarquons, admirons les "pointus" amarrés au quai. Ces barques aux formes galbées, effilées aux extrémités, adaptées à la pêche au trémail dans les eaux profondes de la méditerranée ajoutent une note joyeusement colorée aux ports provençaux. À partir de 1913, la motorisation de ces embarcations à avirons et à voile latine va considérablement améliorer les conditions de travail des marins pêcheurs à qui sera désormais épargné le pénible "vougado" à la rame.
Nous profitons maintenant de la couverture ombrageuse d'une magnifique allée de pins parasols. Deux camionnettes acheminent des citernes d'eau vers la ferme voisine. Éric explique que l'alimentation en eau potable de l'île dépend de pompages dans les nappes de Porquerolles et des rotations du 🔰navire-citerne Saint-Christophe, construit en 1950, qui assure actuellement l’alimentation en eau potable des îles d'Hyères en complément de la ressource insuffisante notamment pendant la saison estivale. La préfecture du Var vient de signer l’arrêté autorisant la mise en œuvre d'une canalisation sous-marine d’alimentation en eau potable qui devrait être posée avant l’été 2023 entre la presqu’île de Giens et l’île. Nous longeons une oliveraie dont Éric nous indique qu'elle est une "collection variétale" concept qui s'oppose à la "monoculture" où une espèce unique jugée rentable est sélectionnée. Les oliviers, ici, sont de différentes espèces et de différentes origines ce qui assure à l'exploitation une qualité et une stabilité supérieures aux monocultures plus sensibles aux maladies et menaçantes au niveau de la conservation des espèces.
Cependant, tout ne ressort pas de ce concept de collection variétale sur l'Île. Ainsi, nous découvrons une plantation d'amandiers puis de figuiers répondant au standard de la monoculture traditionnelle. Une autre culture traditionnelle à Porquerolles est celle de la vigne. Ainsi, on trouve trois domaines viticoles sur l’île. Le vin y est produit en partenariat avec le conservatoire Botanique National de Porquerolles afin de pouvoir protéger l’écosystème de l’île.
Nous attaquons maintenant les chemins parfois exigeants qui traversent le maquis. À l'entrée d'un chemin, 🔰une chaîne enroulée pourrait être déployée pour interdire l'accès au massif forestier en cas de risque majeur d'incendie. Éric explique que la décision de fermeture des chemins appartient au préfet et que ces mesures sont généralement prises pour éviter que des personnes s'engagent et se trouvent ainsi piégées par un éventuel incendie d'ampleur.
La forêt dominée par le chêne vert et le pin d'Alep offre une richesse botanique que notre guide ne se lasse guère de commenter. Nous découvrons ainsi :
- 🔰 la bruyère arborescente qui peut atteindre plus de trois mètres de haut en sous-bois ;
- 🔰 le genévrier à cade dont on tire l'huile de cade recommandée pour calmer les démangeaisons et apaiser la peau, particulièrement en cas de problèmes comme le psoriasis. (Le nom de la célèbre marque Cadum fait référence à cette plante) ;
- 🔰 l'euphorbe dont la sève laiteuse (latex) qui suinte lorsqu'on tranche la feuille est un toxique extrêmement dangereux au contact de la peau, des yeux et des muqueuses ;
- 🔰 la salsepareille facilement reconnaissable avec ses feuilles en forme de cœur et même si la plante est le mets préféré des Schtroumpfs, ses baies rouges sont toxiques pour l'homme ;
- 🔰 l'arbousier, dont es baies ressemblent à de petites fraises et sont comestibles crues ou en confiture ;
- 🔰 le figuier, le plus puissant des arbres, affirme Éric, car ses branches sont capables de pousser les murs les mieux construits. ;
- 🔰 le mimosa qui a la particularité de se régénérer facilement et même de se multiplier après les incendies ;
- 🔰 le cyste aux feuilles légèrement gluantes ;
- 🔰 la lavande papillon ainsi nommée à cause de la forme particulière de ses multiples petites fleurs ;
- 🔰 le houx très haut, quasi arbustif. Les feuilles du bas de l'arbuste conserve leurs piquants caractéristiques tandis que celles du haut, ne risquant pas l'attaque des chèvres à cette hauteur, les ont perdus présentant ainsi un aspect lisse tout à fait inoffensif ;
- 🔰 le myrte, 🔰 le romarin, 🔰 le genêt, 🔰 le pistachier lentisque etc, etc...
Seul le 🔰criste marine, une petite plante appelée aussi 'perce-pierre', parvient à s'accrocher çà et là. D'une saveur salée, les feuilles de la plante, confites dans le vinaigre, se mangent comme les cornichons en condiments. Les bretons utilisent la salicorne de la même façon. Ici, la vue sur la calanque est incomparable. Nous quittons, presque à regret, le chemin littoral et rejoignons le maquis pour rejoindre le village. Plus bas, nous retrouvons des plantations de figuiers et même de palmiers.
Les plus courageux d'entre-nous décident de suivre Éric sur le chemin qui mène au 🔰Moulin du Bonheur. Les ailes du moulin du bonheur ne tournaient plus depuis plus de deux cents ans et il n’en restait que la tour, ruinée et perdue au milieu du maquis. Cette longue absence d'activité tient à la faible rentabilité du moulin du fait que les vents sur l'Île sont beaucoup trop irréguliers. Reconstruit à l’identique dans la tradition des moulins à vent provençaux, il mesure 6 m de haut et 6 m de diamètre. À 200 mètres de ce moulin, s'élève le 🔰Fort Sainte Agathe qui domine le village et le port.Ce fort très imposant a permis, à travers les âges, de surveiller simultanément la rade d’Hyères et le littoral provençal afin de les protéger des brigands et des invasions sarrasines. En 1531, François Ier décidera d’ailleurs d’y intégrer une garnison afin d’assurer la protection des insulaires. Nous voilà de retour au port pour embarquer sur une des vedettes chargées d'acheminer vers le continent les visiteurs de l'île très nombreux à s'entasser sur le quai en fin d'après-midi.
 |
| "Homme libre, toujours tu chériras la mer !" Charles Baudelaire |
👉Le massif de Maures.
Aujourd'hui, troisième jour de rando, nous allons nous éloigner du littoral et rejoindre Collobrières dans l'intérieur des terres. Le ciel est un peu moins bleu que les jours précédents et un léger voile brumeux semble couvrir l'horizon. Collobrières se situe, entre Pierrefeu et Cogolin, sur la route sinueuse et étroite qui serpente au cœur du Massif des Maures, petite chaîne de montagnes qui s'étend entre Hyères et Fréjus. Le radical maur (qui signifie 'brun, foncé, sombre') apparaît dans le provençal 'mauro', 'maura'. Ainsi le mot 'Maures" serait une allusion à l'aspect noir des forêts de pins qui recouvrent le massif, ou encore à une référence à la couleur sombre de ses roches cristallines, qui offrent un contraste avec la couleur claire des roches calcaires du reste de la Provence. L'hypothèse que cet élément 'Maures' pourrait faire référence à une quelconque présence sarrasine n'aurait aucun fondement. À quelques kilomètres à l'est du village de Collobrières, mais toujours sur le territoire de la commune, se dresse majestueuse, la Chartreuse Notre-Dame de Clémence de La Verne. Nous nous sommes garés tout près de l'imposant monastère et Éric nous propose, en avant goût à la visite des bâtiments, une balade tout autour du petit massif de l'Ermitage, ainsi appelé car les chartreux du monastère avaient bâti sur le sommet voisin un petit ermitage permettant aux plus solitaires d'entre eux de trouver un plus grand recueillement dans un isolement encore plus extrême que celui imposé dans la Chartreuse elle-même. Nous prenons donc le chemin de la Crète de la Verne avant de rejoindre la piste des Sivadières qui nous permettra de contourner ce massif forestier de l'Ermitage.Nous sommes immédiatement frappés par la beauté des châtaigniers parfois incroyablement tourmentés ou même présentant d'énormes excavations dans leur tronc noueux rien qui ne semble les empêcher de produire des masses considérables de bogues massives. Le marron est le nom donné ici à la châtaigne quand la bogue contient un fruit unique (ne pas confondre avec 'marron d'Inde' fruit du marronnier). Le terme 'châtaigne' est réservé aux fruits qui se présentent multiples dan une même bogue. Collobrières est réputée pour la qualité de sa crème de marron et de ses marrons glacés. Éric attire notre attention sur un puits horizontal : la galerie à voute de pierres sèches a été creusé horizontalement dan le coteau et débouche sur le chemin barré par une grille ; les eaux de pluie filtrées et minéralisées par le terrain dominant la galerie s'infiltrent par sa voute et peuvent être captées au niveau du débouché sur le chemin. Nous montons insensiblement. En contrebas, on aperçoit le 🔰Barrage de la Verne destiné à la production d'eau potable. C'est un barrage de type "barrage-poids" où la masse des éléments qui le constituent est calculée pour retenir l'eau en s’opposant à la pression horizontale exercée sur la structure du barrage. Le barrage de Serre-Ponçon avec ses 650 mètres d'épaisseur est le plus célèbre des barrage-poids français. (Contrairement aux barrages-poids, les barrages-voûtes remarquables par leur forme en arc, leurs dimensions et leur finesse tirent au maximum partie de la capacité de résistance des matériaux et du rocher de fondation.)
Malgré le léger voile de brume, nous ne tardons pas à entrevoir dans le lointain la baie de Saint Tropez et Saint Raphaël plus à l'est. En fait, le littoral depuis Fréjus jusqu'à Hyères (en passant par Sainte-Maxime, Saint Tropez, Cavalaire, le Lavandou, Bormes-les-Mimosas), appartient à ce Massif cristallin des Maures. La vue porte sur l'immense forêt qui couvre toute la perspective. Éric nous apprend que le Var est classé premier département forestier de France devant les Vosges, ce qui, selon lui, ne constitue pas forcément une bonne nouvelle tant cette performance implique le recul de l'espace agricole et des pâtures. Le maquis et la garrigue sont des formations végétales typiques de la Provence. Le maquis pousse sur des sols acides (roches métamorphiques, schiste, grès) tandis que la garrigue est plus caractéristique des sols calcaire. Ces types de végétation sont consécutifs tant aux incendies qu'à la déforestation massive qui a longtemps touché la Provence. Aujourd'hui, la densité du couvert végétal donne l'impression d'un milieu "naturel"; le touriste qui s'aventure l'été dans ces "solitudes" est persuadé qu'il retrouve la beauté des forêts primitives. En fait, "l'homme ne rencontre plus que lui-même" car le paysage actuel est le reflet de séculaires transformations. La déforestation fut liée à quelques principaux facteurs : l'agriculture sur brûlis, les immenses besoins du chemin de fer en traverses de bois, les besoins dans le bâtiment (charpente, bardage, couverture...), l'activité minière, le bois de chauffage... Depuis Colbert, on s'efforce de répondre à cette problématique, par des politiques de replantation, de gestion des forêts etc...
On exporte par exemple des espèces provençales d'arbres mieux adaptés à la sécheresse vers les Vosges. Dans le même esprit, on fat venir en terre provençale des cèdres du Maroc dont on sait qu'ils pourront mieux supporter les rigueurs liées au réchauffement climatique. Éric attire notre attention sur un 🔰chêne pubescent (aussi appelé chêne rouvre). Le dessous des feuilles présente un léger duvet de poils très fins tandis que la face supérieure de la feuille est d'un beau vert brillant. Il s'agit d'un exemple d'adaptation de l'espèce à la sècheresse, les poils sous les feuilles retiennent l'humidité qui monte du sol, tandis que la face brillante de la feuille renvoie le rayonnement qu'elle reçoit du haut. Les fines aiguilles des conifères sont également une stratégie anti-sécheresse que développe l'arbre en limitant ainsi la surface de la feuille et donc l'évaporation liée aux fortes chaleurs. Dans ce maquis dominé par le chêne vert, le chêne liège et le châtaignier nous allons découvrir une petite forêt de cèdres de l'Atlas qui occupent près de deux hectares. Plantés fin du 19e siècle, ils atteignent aujourd'hui des dimensions considérables.
La chartreuse fut fondée en 1170 par les évêques de Toulon et de Fréjus. Rapidement le domaine gagna en superficie grâce à des donations en échange d'oraisons, permettant ainsi aux moines de vivre de la culture et de l'élevage. Ils obtinrent aussi au XIII ème siècle le droit d'exploiter le sel des salines d'Hyères. Une succession de malheurs s'abattit sur la chartreuse au cours des siècles. Il y eut ainsi plusieurs incendies aux XIIIème et XIVème siècles qui ravagèrent les bâtiments. De plus, toutes ces richesses accumulées grâce aux nombreux dons, n'étaient pas sans attirer les convoitises des seigneurs voisins qui nourrirent pendant des siècles une véritable haine envers les chartreux. Plusieurs procès éclatèrent entre ces rivaux. Les moines connurent aussi des troubles de voisinage avec les gens de Collobrières. Puis ce furent les luttes contre les huguenots durant les guerres de religion de la fin du XVIème siècle. Mais jamais les moines ne renoncèrent à vivre dans ce havre. Et après chaque tempête, ils trouvèrent en leur foi la volonté pour reconstruire encore et toujours. Finalement la Révolution les poussa à quitter les lieux pour se réfugier en Italie. Tout ce qui avait une quelconque valeur fut confisqué et vendu. La chartreuse se dégrada très sensiblement. Ses vieux édifices tombèrent totalement en ruines.
En 1968, une association d'amoureux de la Verne entreprit une vaste campagne de préservation et de restauration. L'équipe dynamique qui se constitue alors, réalise entre 1969 et 1982 avec beaucoup d'énergie et d'envie, des travaux importants qui sortent progressivement la chartreuse de l'oubli. Dès 1986, commencent, avec l'aide des collectivités, des travaux beaucoup plus importants de rénovation de l'ensemble des bâtiments qui verront notamment renaître l'église romane et le grand cloître.
Nous allons ainsi découvrir le petit cloître puis le grand cloître dont les cellules ont été rebâties, (une cellule témoin permet d'apprécier la stricte condition d'isolement de la vie monacale, une échauguette, l'atelier, les cuisines (avec une cheminée du XIIème siècle), l'hôtellerie, le réfectoire, un pressoir à huile d'olive. Les arcades et portes sont décorées en 🔰serpentine, un marbre vert sombre extrait d'une carrière de La Môle, village proche de Cogolin. 🔰L'église au centre du monastère est impressionnante de beauté austère. Une salle consacre une exposition photos retraçant l'évolution de la restauration depuis les ruines initiales jusqu'à la merveille qu'est devenu le monastère aujourd'hui. Nous sommes impressionnés par l'ampleur et la qualité des travaux mis en œuvre. Depuis 1990, la chartreuse accueille des moniales de la famille monastique de Bethléem, de l’Assomption de la Vierge et de Saint Bruno. Aujourd'hui, elles sont une trentaine à vivre et prier dans ces lieux. Elles se sont spécialisées dans la décoration de poteries diverses en vente dans un vaste magasin d’artisanat monastique à côté de tout un tas d'articles : livres, miel, parfums, santons, objets religieux, etc... Quelques uns parmi nous cèdent à l'originalité du lieu et s'acquittent de quelques achats.
Rendez-vous est donc pris à 14h00 sur le parking proche du mur d'enceinte du Château d'Hyères dont on aperçoit les tours de très loin. Elles semblent naître du rocher lui-même au sommet duquel le château est construit. Épousant parfaitement l'aspect conique du rocher, le Château s'élève en une succession de niveaux depuis l'enceinte principale percée d'une unique porte jusqu'au donjon, tout en haut, dont il ne reste rien que son emplacement supposé. Ici, les banquets fastueux, les chevaliers et les dames ont laissé place aux chênes majestueux, aux mousses galopantes et aux visiteurs attentifs. Depuis l'emplacement où se dressait jadis le donjon, on jouit d'un panorama sur toute la côte, de Toulon au Cap Bénat, en passant par la presqu'île de Giens et les Îles d'Hyères.
Le château date en toute vraisemblance du XIème siècle. Pendant guerres de religion de la fin du XVIème siècle il eut à pâtir des rivalités entre catholiques et protestants. Finalement, en 1596, après des années de siège, Henri IV s'en empara et ordonna que l'on rase l'édifice et c'est son successeur, Louis XIII qui se chargea de le démanteler totalement. Aussi a-t-on aujourd'hui le plus grand mal à se rendre compte de l'importance du site dont de nombreux murs et tours furent abattus. Heureusement, des pancartes sont là pour expliquer, plans à l'appui, à quoi ressemblait le château jadis et où se trouvaient les puits, portes, etc...
Par delà la première enceinte castrale du château, se trouvent deux enceintes circulaires qui furent dressées au fur et à mesure que le bourg prenait de l'importance afin de protéger la population. Descendre la colline sur laquelle s'étire la ville revient, en quelque sorte, à suivre le cours des siècles depuis le passé jusqu'au présent.
La rue St Pierre est la limite de la première enceinte. Elle est appuyée sur une partie des restes de l'église de l'Abbaye Saint-Pierre de l'Almanarre, fondée en 989. Les ruines ont fait l'objet de fouilles. Dans une partie de la Rue St Pierre, le sol est fait d'une dalle à cupules, de l'époque néolithique. Ces cupules sont des creux faits par l'homme. Leur présence sur cette colline témoigne de l'ancienneté de l'habitat qui remonte à la Préhistoire.
Une superbe 🔰calade (voie pentue pavée de galets) mène au 🔰Castel Saint Claire. C'est une des rares maisons construites au 19ème siècle à l'intérieur des remparts. Elle a été bâtie en 1848 par le Colonel Olivier Voutier, découvreur de la Vénus de Milo. Cette construction a été bâtie en lieu et place du couvent des Clarisses qui était en charge de l'éducation des jeunes filles. Le Jardin qui l'entoure est très riche en espèces différentes et rares.
La 🔰tombe du colonel se trouve sur la plus haute terrasse des jardins. Il nous faut, à présent, remonter la très pentue Rue Saint Pierre. Une splendide vue, en contrebas, sur la lourde masse romane de la 🔰collégiale Saint Paul avec son petit clocher-campanile nous console de la difficulté de l'ascension.
Depuis la place Saint-Paul, un escalier descend vers le 🔰lavoir de la rue du Repos. Ces marches de longueurs inégales étaient destinées à "casser le pas de charge" d'un éventuel assaillant. Construit en 1888, ce lavoir, était à l’abandon mais a été intégralement restauré et remis en eau en 2018. La plateforme du lavoir, avec ses plaques de lave émaillées sur lesquelles figurent des photos d'archive, a vocation à accueillir des manifestations culturelles et festives.
Plus bas, nous marquons un arrêt devant la 🔰Tour des Templiers qui s'élève sur la Place Massillon. La Tour des Templiers, également appelée chapelle Saint Blaise, est l'ultime vestige de la commanderie que les Templiers fondèrent à Hyères. Il s'agit d'un édifice majeur d'un type extrêmement rare composé à l'origine de 2 chapelles superposées (ou d'une chapelle surmontée d'une salle de gardes) et couvert d'une toiture en terrasse.
Je me suis programmé un peu de tourisme aujourd'hui et je ne peux donc pas accompagner le groupe pour cette rando au Plan d'Aups au cœur du massif de la Sainte Baume. Aussi, les lignes qui suivent pourront présenter un caractère trop impersonnel.
Il faut arpenter un petit sentier au milieu des lapiaz (ciselures superficielles creusées par les eaux en terrain calcaire) pour atteindre la 🔰chapelle du Saint Pilon. D'après la tradition, sainte Marie-Madeleine venait sept fois par jour prier sur ce lieu élevé, portée par des anges qui l'amenaient par la voie des airs. En 1463, on érigea un pilon (pilier) surmonté d'une statue à l'effigie de la Sainte portée par les anges. Ce pilon a depuis disparu.
De la petite route D95, un chemin conduit à la glacière de Pivaut. La glace était utilisée de multiples façons : pour la conservation du poisson frais, des aliments, dans les hôpitaux, pour les boissons, en sorbets,... C'était un marché juteux, et rien que dans ce massif de la Sainte Baume on compte une vingtaine de glacières. La glacière de Pivaut n'est pas la plus ancienne mais elle est la plus impressionnante. Le principe de fabrication de la glace n'était pas très sorcier mais sa mise en œuvre était plus complexe : L'hiver, on acheminait l'eau jusqu'à de grands bassins de congélation profonds d'une quinzaine de centimètres et pouvant contenir environ 250 mètres cube chacun. A la faveur des nuits froides et des vents secs soufflant en bordure des bassins, l'eau se transformait en glace. Le jour, les paysans pour "arrondir" leurs fins de mois, sciaient la glace en blocs et la charriaient jusqu'à la glacière où on la tassait et la compactait au fond de l'immense réservoir. Une fois la glacière pleine, on la scellait à l'aide d'une triple porte. L'été, le travail se faisait le soir et toute la nuit. Il consistait cette fois-ci à sortir la glace et à l'acheminer jusqu'aux points où les gens en avaient besoin, principalement les grandes villes que l'on atteignait en une nuit. Puis il fallait tailler les pains de glace qu'on chargeaient sur des charrettes. On les protégeait de la chaleur avec des couvertures de laine et de la paille pour aller les livrer avant le lever du soleil.
Nous parvenons à la Pointe d'Escampobarriou. Ce nom provençal (échappée des tonneaux) viendrait du fait que les barriques acheminées par bateau se renversaient parfois à la mer à cet endroit où le clapot et la houle sont très confus et chahutent les navires. Le site a porté des batteries militaires dès 1870. Les ruines qu'on trouve aujourd'hui correspondent à des positions allemandes de la seconde guerre mondiale. La batterie fut détruite lors du débarquement de Provence. Des impacts de balles subsistant dans la maçonnerie d'un dépôt à munition et un amas de ruines témoignent de l'acuité des combats. Plus haut, on aperçoit les 'grandes oreilles' du réseau espion FRENCHELON d’écoute des télécommunications déployé par les services de renseignement militaire français, créé sur le modèle d’ECHELON, son précurseur anglo-saxon. Au retour vers la Madrague, nous empruntons un cheminement forestier plus éloigné du littoral longeant les limites du camp militaire installé dans cette partie de la presqu'île.
Les habitants de la presqu'île sont les Arbanais. L'origine de ce nom étrange fait l'objet de diverses hypothèses plus ou moins fantaisistes. L'une d'elle a retenu mon attention non qu'elle soit spécialement crédible mais elle est bien jolie : Les bateaux arabes approchant Toulon passaient près des Îles d'Hyères. L'île du Levant puis Port-Cros, Porquerolles et enfin Giens qui était encore une île avant la formation des tombolos. Giens était donc la quatrième île sur ce passage maritime. 'Quatre' se dit 'Arba' en arabe d'où, selon cette hypothèse, l'usage du mot Arbanais pour désigner les habitants de cette quatrième île.
Une autre légende sur ces îles vaut d'être citée : Il était une fois un bon roi de Provence qui avait quatre filles, quatre perles adorées dans tout le royaume. Un jour qu'elles se baignaient dans la mer, un navire de pirates venu de par-delà l'horizon, s'approcha des côtes, dans le but de ravir ces quatre merveilles qui trop éloignées du rivage ne pourraient regagner la terre ferme. Voyant cela, le bon Roi supplia les dieux d'aider ses filles à échapper aux vils desseins de ces kidnappeurs. C'est alors que les quatre belles furent changées en quatre magnifiques îles. Ainsi naquirent Le Levant, Port-Cros, Porquerolles et Giens dont le double tombolo correspond aux bras de la quatrième princesse qui, de désespoir, les avait tendus jusqu'à toucher le rivage.
Éric nous propose, comme ultime rando la visite des salins pour clore en beauté notre séjour. Rendez-vous est donc donné sur le parking de Kaïna Beach à l'entrée des salins. Nous sommes ici à l'extrémité sud-est de l'immense commune d'Hyères au delà de l'embouchure du Gapeau. (Hyères, avec tous les territoires qu'elle englobe, est la 🔰dixième commune de France avec une superficie de 132 km² bien avant Paris et ses 105 km²).
Mais au fait, pourquoi la mer est-elle salée ? C'est évidemment la question préalable à tout autre développement. Il y a plusieurs centaines de millions d'années, alors que la planète était encore toute jeune, l'eau des mers était douce. Elle s'est peu à peu chargée en sel du fait du continuel essorage des terres par les eaux de pluie qui se minéralisent au travers des terrains. Cette minéralité se retrouve dans les rivières et les fleuves et se concentre peu à peu dans les océans. Le sel constitue une part certes négligeable de la minéralisation des eaux de pluie (Éric nous montre cette mention sodium sur l'étiquette d'un petite bouteille d'eau minérale). Mais le temps, à l'échelle géologique, est infiniment patient et ce sont des centaines de milliards de tonnes de la fameuse molécule NaCl qui sont aujourd'hui en solution dans les eaux maritimes.
Les bassins étant sous le niveau de la mer, un système de captation permet de les alimenter, à la demande, en eau de mer. L'astuce consiste à multiplier en étendue des bassins peu profonds qui communiquent les uns avec les autres grâce à des systèmes mécaniques de régulation appelés 'tympans'. Le phénomène d'évaporation favorisé par le climat sec joue à plein et, d'un bassin à l'autre, l'eau se concentre de plus en plus en sel. Avant que la dernière molécule d'eau se soit évaporée et que le sel puisse être récolté, le bassin présente une très forte salinité qui favorise le développement d'une algue rouge. Nous pouvons observer un de ces bassins qui présente ces magnifiques reflets roses. C'est cette algue absorbée par les crevettes qui leur donne une couleur rose. Et comme les flamands mangent beaucoup de crevettes, ils se parent de cette belle couleur qui les magnifie. Nous marquons un arrêt dans les locaux de l'Espace Nature des Vieux Salins. Les locaux sont gérés par la LPO. On y trouve une riche exposition pédagogique sur la faune et la flore des marais. Une terrasse s'ouvre à l'étage offrant une large perspective sur l'ensemble des bassins. Une lunette d'observation est mise à disposition. Nous achevons le tour des bassins attentifs au comportement des colonies de flamands plus ou moins roses qui peuplent les lieux.
Éric nous conduit maintenant au petit Port Pothuau appelé aussi Port des Salins. C'est un charmant petit port accueillant de petites embarcations sur un nombre réduit de mouillages. Un bateau militaire assure la liaison avec les bases situées sur l'Île du Levant. Un bateau civil permet le transport du personnel civil qui travaille sur ces mêmes bases. Cependant, pour les touristes, aucune liaison avec le Levant n'est possible à partir de ce port. Le canal d'alimentation en eau de mer des salins prend naissance ici à partir des eaux du port. Un pontet permet de le franchir. On peut observer le mécanisme de régulation de l'alimentation. Une grande et belle roue en bois est connectée à un système de vannes d'écluse permettant l'ouverture ou la fermeture des eaux de mer s'écoulant dans le canal. L'ensemble pontet/mer/canal/roue éclusière, a un charme incontestable. Éric indique qu'un dispositif de captation existait aussi à La Capte (d'où le nom 'Capte') pour alimenter le Salin des Pesquiers situé entre les deux tombolos de Giens. Nous nous attardons sur les quais du petit port d'où on peut clairement voir au loin les structures du 🔰Fort de Brégançon, la résidence de villégiature du chef de l'État. Il ne nous reste plus qu'à rejoindre le parking tout proche, à saluer Éric une dernière fois et à le remercier pour toutes ses qualités professionnelles et humaines qui nous ont instruits et ravis tout au long de la semaine.
💓💙💚💛💓💙💚💛💓💙💚💛💓💙💚💛💓💙💚💛💓💙💚💛💓💙💚💛💓💙💚💛💓💙💚💛💓💙💚💛💓💙💚💛💓💙💚💛
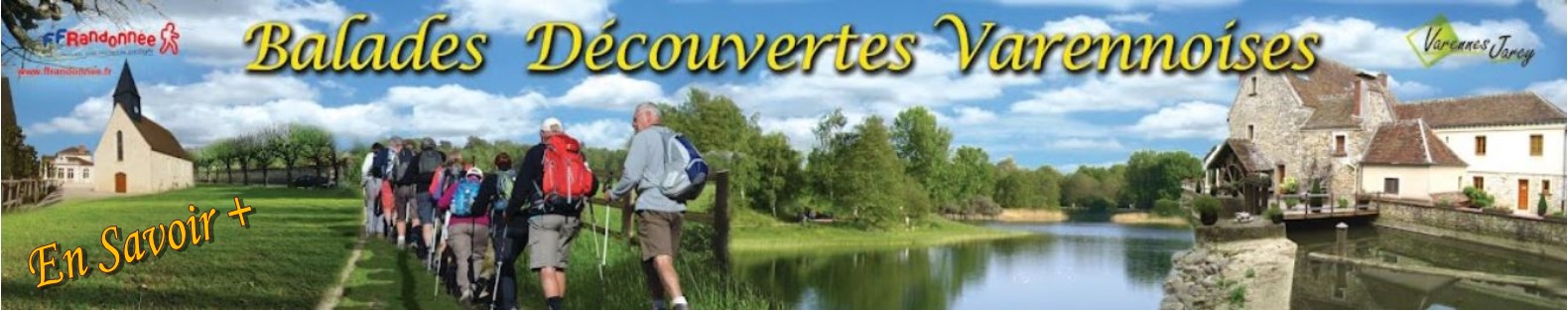
















%20(1024x683).jpg)



















































%20(1024x683).jpg)






%20(1024x683).jpg)




