Didier nous propose aujourd'hui une balade d'un peu plus de 9 km dans l'immense domaine du Château de Fontainebleau, l'occasion pour nous d'une réjouissante plongée dans huit siècles d'histoire. En effet, Fontainebleau n'est pas le château d'une seule époque ou d’un seul souverain. C'est, au contraire, le résultat d'une royale transmission de génération en génération depuis le Moyen-Âge jusqu'au 19ème siècle. Chaque souverain l’a façonné au goût de son époque et y a laissé son empreinte. Aujourd’hui, les visages de l’immense palais sont aussi nombreux que les souverains qui l’ont habité. Didier, notre cicérone du jour, a su réunir une documentation concise pour nous éclairer sur cette complexité de références historiques, stylistiques et artistiques.
Nous nous sommes garés, près des grilles de la rue des Cascades au Sud du domaine. Un sentier sur notre droite, juste avant le passage des grilles, contourne le domaine par le sud, longeant les jardins à la française du Grand Parterre, et offre un très beau panorama sur l'immense bâti du château.
Les photos qui illustrent ce compte rendu sont l'œuvre de Didier Armanini.
👉Passez la souris sur les petits symboles 🔰 pour ouvrir d'autres photos. (Puis cliquez sur la photo pour la masquer.) Passez la souris sur le symbole🔰 pour ouvrir une photo. Puis cliquez sur la photo pour la masquer.
Un peu d'histoire.
Didier profite de cette large perspective pour nous donner quelques informations sur la longue histoire des lieux. De l'époque médiévale ne subsiste que le donjon carré qui s'élève au centre de la perspective. L'ancien château médiéval était probablement un rendez-vous de chasse royale dans la Forêt de Bières (qui ne s'appelait pas encore Fontainebleau).
Au 16ème siècle, à partir de 1528, François 1er fait reconstruire le château. Pour meubler et décorer les lieux, il fit appel à des artistes italiens notamment "le Rosso" et "le Primatice" qui fondèrent la première École de Fontainebleau qui constitue le premier point d'enracinement de la Renaissance Italienne en France. Ce mouvement culturel, artistique, architectural, philosophique, scientifique va peu à peu influencer toute l'Europe du Nord.
L'humanisme caractérise cette époque nouvelle en rupture avec l'austérité du Moyen Âge où l'Homme envisagé comme pécheur n'avait d'autre alternative que le repentir, l'absolution, la pénitence.
L'antiquité est remise à l'honneur. On étudie les textes des anciens. L'imprimerie naissante permet la diffusion des idées nouvelles dans les cercles d'érudits. On reproduit la statuaire antique.
La porte Dorée, inspirée de l'architecture italienne, marque l'entrée de la Cour Ovale, autour de laquelle se déploient les appartements royaux et la Salle de Bal, achevée sous Henri II.
La porte Dorée, inspirée de l'architecture italienne, marque l'entrée de la Cour Ovale, autour de laquelle se déploient les appartements royaux et la Salle de Bal, achevée sous Henri II.
Cette cour est reliée à une cour secondaire, devenue aujourd'hui cour d'Honneur, par la galerie François 1er.
L'aile de la Belle Cheminée, conçue par Primatice, avec son étonnant escalier à double rampe, est un exemple accompli de la renaissance italienne adapté pour la France.
Au 17ème siècle, Henri IV est l'autre grand bâtisseur du château. Il ouvre et agrandit la Cour Ovale, la dote de la Porte dite du Baptistère. Elle fait face à une nouvelle cour des communs ou Cour des Offices. Henri IV fait aussi bâtir l'aile abritant deux galeries superposées, la Galerie de Diane et la Galerie des Cerfs, la Volière et le jeu de Paume.
L’événement bellifontain le plus marquant du règne de Louis XIV se déroula le 18 octobre 1685. Par l’édit de Fontainebleau, le roi révoqua, sans sourcilier, l’édit de Nantes de 1598 par lequel Henri IV avait octroyé une certaine liberté de culte aux Protestants français. Cet édit obligea les Protestants à se convertir ou à quitter le royaume.
Au 18ème siècle : Louis XV fait remplacer l'ancienne Galerie d'Ulysse par un bâtiment plus spacieux et bâtir le Gros Pavillon.
A la révolution, le château est vidé de ses meubles, mais les bâtiments sont épargnés.
Au 19ème siècle : Napoléon 1er fait du château sa résidence impériale qu'il remeuble. L'aile de Ferrare est détruite et remplacée par la grille actuelle.
Sous le règne de Louis-Philippe, la Volière est abattue. Les travaux sous Napoléon III portent essentiellement sur les décors intérieurs.
L'Étang aux Carpes.
Nous nous dirigeons vers la Porte de Maintenon, passons devant les bâtiments de la Société équestre de Fontainebleau et atteignons la berge de l'Étang aux Carpes. Madame de Maintenon (Françoise d'Aubigné) maitresse, puis secrètement mariée à Louis XIV avait ses appartements au premier étage de la Porte Dorée. Louis XIV adorait Fontainebleau. C'est sous ses directives que André Le Nôtre créa de 1660 à 1664, le Grand Parterre à la régularité classique, entraînant la disparition des "petits jardins" d’Henri IV.
Nous atteignons la berge de l'Étang aux Carpes. C'est encore pour Louis XIV que Louis Le Vau éleva le petit pavillon à pans qui subsiste aujourd'hui au centre de l'étang. Ouvrant sur le midi, l’étang aux carpes doit son nom aux fameuses carpes dont la présence à Fontainebleau est attestée depuis Henri IV. À l’est, les eaux de l’étang sont retenues par une digue baptisée "allée de Maintenon". Cette pièce d’eau de six hectares, servit de cadre aux somptueuses festivités nautiques de la cour des Valois.
Au 19ème siècle : Napoléon 1er fait du château sa résidence impériale qu'il remeuble. L'aile de Ferrare est détruite et remplacée par la grille actuelle.
Sous le règne de Louis-Philippe, la Volière est abattue. Les travaux sous Napoléon III portent essentiellement sur les décors intérieurs.
L'Étang aux Carpes.
Nous nous dirigeons vers la Porte de Maintenon, passons devant les bâtiments de la Société équestre de Fontainebleau et atteignons la berge de l'Étang aux Carpes. Madame de Maintenon (Françoise d'Aubigné) maitresse, puis secrètement mariée à Louis XIV avait ses appartements au premier étage de la Porte Dorée. Louis XIV adorait Fontainebleau. C'est sous ses directives que André Le Nôtre créa de 1660 à 1664, le Grand Parterre à la régularité classique, entraînant la disparition des "petits jardins" d’Henri IV.
Nous atteignons la berge de l'Étang aux Carpes. C'est encore pour Louis XIV que Louis Le Vau éleva le petit pavillon à pans qui subsiste aujourd'hui au centre de l'étang. Ouvrant sur le midi, l’étang aux carpes doit son nom aux fameuses carpes dont la présence à Fontainebleau est attestée depuis Henri IV. À l’est, les eaux de l’étang sont retenues par une digue baptisée "allée de Maintenon". Cette pièce d’eau de six hectares, servit de cadre aux somptueuses festivités nautiques de la cour des Valois.
Le Jardin à l'Anglaise.
Nous entrons maintenant dans le Jardin à l'Anglaise. L’aménagement de ce jardin paysagé à l’anglaise, en 1810-1812, est dû à Hurtault, l’architecte de la grille d’Honneur. Paradoxalement, c'est Napoléon 1er qui en fit la commande bien qu'il n’appréciait pas particulièrement les jardins de ce type. Il dut céder au goût du jour et à la mode de ces jardins tentant d'imiter au plus près les grands espaces naturels. Planté d’essences rares du monde entier et aménagé de chemins étroits et sinueux, il est parcouru d’une rivière artificielle et renferme encore, dans ses recoins secrets, la 🔰Fontaine Belle-Eau dont le nom est à l'origine du mot "Fontainebleau". Ce joli jardin à l'anglaise succéda, au cours du 19ème siècle, à une série de jardins, maintenant disparus, qui furent créés sous le règne de François 1er dans cette partie ouest du domaine.
Nous nous arrêtons devant une admirable statue représentant un "Gladiateur Mourant". L'occasion de rassembler les dames du groupe pour une photo devant le corps athlétique de l'antique combattant. Cela ne provoquera pas la moindre émotion chez ces dames tant elles ont l'expérience heureuse de la présence du mâle corps sculptural de leur époux.
Ce magnifique bronze est très représentatif de la statuaire des jardins à Fontainebleau et témoigne du goût immodéré des artistes de la Renaissance pour les œuvres et les techniques de l'Antiquité.
Cette grande cour au plan régulier du 16éme siècle s’est progressivement imposée comme la cour principale du château. On l'appelle "Cour du Cheval Blanc" car un cheval de plâtre l’ornait en son centre. Au fond on remarque le
🔰pavillon de l’Horloge,
la chapelle de la Trinité et l’emblématique escalier en fer-à-cheval.
Sur notre gauche, s'étend l'Aile des Ministres et sur notre droite l'Aile Louis XV. Nous approchons de l'escalier magnifiquement restauré en 2022. Construit à la demande de Louis XIII entre 1632 et 1634 et attribué à l’architecte Jean Androuet du Cerceau, il remplace le vieil escalier que François 1er avait fait bâtir pour permettre l’accès à la galerie François Ier et aux Grands Appartements du château.
Sur notre gauche, s'étend l'Aile des Ministres et sur notre droite l'Aile Louis XV. Nous approchons de l'escalier magnifiquement restauré en 2022. Construit à la demande de Louis XIII entre 1632 et 1634 et attribué à l’architecte Jean Androuet du Cerceau, il remplace le vieil escalier que François 1er avait fait bâtir pour permettre l’accès à la galerie François Ier et aux Grands Appartements du château.
Napoléon Ier avait séjourné à Fontainebleau en 1804, 1807, 1809 et 1810 et c’est là qu’il se retira le 31 mars 1814, jour de la capitulation de Paris. Trois jours plus tard, il apprit que le Sénat avait voté sa déchéance. Il signa à Fontainebleau son acte d’abdication le 6 avril.
Le 20 avril, il descendit le grand escalier en fer à cheval et se rendit dans la cour du Cheval Blanc où l’attendaient les soldats de sa garde. Il s'adressa aux grognards en ces termes : « Soldats de ma vieille garde, je vous fais mes adieux. Depuis vingt ans, je vous ai trouvés constamment sur le chemin de l’honneur et de la gloire. »
L’escalier en Fer-à-cheval entra alors dans la légende. Il s’inscrit définitivement comme l’emblème de Fontainebleau. Depuis ce 20 avril 1814, La grande Cour d'Honneur, devenue la plus célèbre du château de Fontainebleau, est aussi appelée "Cour des Adieux".
L'escalier de Jean du Cerceau a frappé les esprits des contemporains, il est devenu une référence architecturale, copié au château de Courance, de Bourron, dans la cour Visconti du Louvre ainsi qu'au palais princier de Monaco.
Un petit tour en ville.
Nous passons maintenant entre la "Salle du Jeu de Paume" et "le Gros Pavillon" pour rejoindre la Grille de la Rue Denecourt. Didier a programmé cette sortie du Domaine pour effectuer quelques centaines de mètres de marche dans les rues de la Ville et découvrir ainsi les splendides bâtiments qui abritent la 🔰Mairie et un peu plu loin l'Église Saint-Louis. Au moment où nous arrivons, on procède à une cérémonie de funérailles. Aussi, préférons nous respectueusement nous abstenir de faire la visite des lieux. Cette Église Saint-Louis est une belle bâtisse du 17ème siècle. Henri IV érigea un mur d’enceinte au parc du château afin de pouvoir y chasser le gibier, obligeant les fidèles à parcourir près de trois kilomètres supplémentaires pour rejoindre leur petite église Saint Pierre d'Avon au sud du Parc. Il fut alors décidé, à la grande satisfaction des paroissiens, de construire cette église nouvelle au nord, à Fontainebleau même. Récemment, en 2016, une partie de l'église et des œuvres importantes furent détruites par un incendie criminel. Au même moment, la Croix de Guise, en forêt de Fontainebleau, était retrouvée renversée, et l'église Saints-Philippe-et-Jacques de Veneux-les-Sablons partait également en fumée. On ne tarda pas à trouver le coupable, un marginal de 48 ans. La justice le considérera pénalement irresponsable en raison des lourds troubles psychiatriques qu'il présentait.
Nous voilà de retour dans le Domaine du Château. Didier nous mène à la Porte du Baptistère fermée par une grille à travers laquelle on peut observée la Cour Ovale.
Cette cour correspond à l’emplacement du premier château médiéval. Elle est ainsi le cœur historique du château où se dresse encore la grosse tour carrée du vieux donjon médiéval. Elle fut entièrement reconstruite dès 1528 par François 1er. Elle fut, durant des siècles, la véritable cour d’honneur du château.
La Cour Ovale ouvre au midi par le porche d’entrée, orné des fresques de Primatice, de la
🔰Porte Dorée.
D’un aspect tenant à la fois du châtelet médiéval français et des résidences des princes italiens, cette porte monumentale démontre la volonté de François Ier de magnifier l’entrée de sa résidence rénovée.
Cette porte resta, durant des siècles, l’entrée principale du château.
Souhaitant rehausser la majesté de cette cour d'honneur, Henri IV tenta d'en corriger l'asymétrie en lui appliquant un plan en U. Il fit prolonger les bâtiments de cette cour, doublant sa profondeur.
À l’est, où nous nous trouvons, il fit élever, vers 1606, une porte triomphale surmontée d’un dôme à pans, la 🔰Porte du Batistère. Elle tient son nom étrange du baptême du jeune Louis XIII, fils d’Henri IV, qui s’était déroulé, le 14 septembre 1606, dans la Cour Ovale. La porte est ornée de sculptures figurant des victoires qui soutiennent les armes d’Henri IV. Elle permet le passage de la Cour Ovale à la Cour des Offices qui s'étend vers l'est.
Là encore une grille verrouillée empêche d'entrer dans cette large Cour des Offices, aussi nommée "quartier Henri IV".
À l’est, où nous nous trouvons, il fit élever, vers 1606, une porte triomphale surmontée d’un dôme à pans, la 🔰Porte du Batistère. Elle tient son nom étrange du baptême du jeune Louis XIII, fils d’Henri IV, qui s’était déroulé, le 14 septembre 1606, dans la Cour Ovale. La porte est ornée de sculptures figurant des victoires qui soutiennent les armes d’Henri IV. Elle permet le passage de la Cour Ovale à la Cour des Offices qui s'étend vers l'est.
Là encore une grille verrouillée empêche d'entrer dans cette large Cour des Offices, aussi nommée "quartier Henri IV".
Elle est encadrée de trois ailes monumentales en grès, briques et moellons enduits qui abritaient les communs et les cuisines. Elle est accessible depuis la ville par une porte ouvrant sur l'avant-cour où nous sommes.
Cette avant-cour entre la Cour Ovale et la Cour des Offices ouvre également, par une troisième grille, sur le Jardin de Diane qui s'étend vers le nord. Cette grille est malheureusement aussi
🔰cadenassée
que ses deux voisines. le Jardin en plein travaux de restauration est provisoirement fermé au public. Le Jardin de Diane était réservé aux épouses. Il est bordé des espaces les plus intimes des souveraines : petits Appartements de l’Impératrice, boudoir Turc de Marie-Antoinette.
Ce Jardin de Diane est planté d’arbres remarquables comme le catalpa ou le tulipier de Virginie. Ce beau jardin paysagé à l’anglaise, tire son nom d’une fontaine ornée d’une statue de Diane chasseresse. C'est la seule fontaine qui subsiste encore à Fontainebleau parmi les nombreuses riches fontaines créées sous Henri IV aujourd'hui disparues.
Elle est positionnée au centre d’un bassin circulaire à gradins. Sur la partie basse d’un piédestal présentant en majesté la déesse armée de son carquois, quatre têtes de cerfs en bronze, exécutés par Pierre Biard, ainsi que quatre chiens, rappellent que Fontainebleau était considéré comme le "temple de Diane", château de chasse prisé par les souverains.
Le Grand Parterre.
Nous entrons, à présent, dans les jardins à la française du "Grand Parterre" magnifiquement agrémentés par de multiples 🔰parterres chamarrés.
Ce Grand Parterre, le plus vaste d’Europe avec ses 14 hectares fut créé de 1660 à 1664 par André Le Nôtre et Louis Le Vau. Il est le résultat de la volonté de Louis XIV de magnifier et de clarifier les jardins à Fontainebleau dans un style purement classique. Ainsi on fit supprimer les broderies de buis des anciens jardins. On garda cependant le tracé originel des compartiments d’herbe. On restaura le grand bassin carré qu'on orna d'une statue. Plus tard, en 1817, une large vasque, dite "le pot bouillant", prit place au centre de cette magnifique géométrie. Tout au fond, près de la forêt, on enrichit l'immense rond d’eau d'une splendide réplique de l'antique "Statue du Tibre avec Romulus et Rémus".
Nous sortons du Grand Parterre par l'est. Quatre 🔰Sphinges en grès, déesses léonines sculptées par Lespagnandelle en 1664, marquent la frontière entre le Parterre et le Parc qui s'étend à l'est de la route des Cascades.
Le Grand Parterre.
Nous entrons, à présent, dans les jardins à la française du "Grand Parterre" magnifiquement agrémentés par de multiples 🔰parterres chamarrés.
Ce Grand Parterre, le plus vaste d’Europe avec ses 14 hectares fut créé de 1660 à 1664 par André Le Nôtre et Louis Le Vau. Il est le résultat de la volonté de Louis XIV de magnifier et de clarifier les jardins à Fontainebleau dans un style purement classique. Ainsi on fit supprimer les broderies de buis des anciens jardins. On garda cependant le tracé originel des compartiments d’herbe. On restaura le grand bassin carré qu'on orna d'une statue. Plus tard, en 1817, une large vasque, dite "le pot bouillant", prit place au centre de cette magnifique géométrie. Tout au fond, près de la forêt, on enrichit l'immense rond d’eau d'une splendide réplique de l'antique "Statue du Tibre avec Romulus et Rémus".
Nous sortons du Grand Parterre par l'est. Quatre 🔰Sphinges en grès, déesses léonines sculptées par Lespagnandelle en 1664, marquent la frontière entre le Parterre et le Parc qui s'étend à l'est de la route des Cascades.
Le Grand Canal dans la Grande Prairie.
Nous marquons un arrêt à la terrasse des Cascades pour observer le Bassin des Cascades orné en son centre d’un 'Aigle défendant sa proie' du sculpteur Cain. Au delà du bassin, s'impose, en contre-bas, la perspective du Grand Canal qui s'allonge, parfaitement rectiligne, sur toute la longueur de la Grande Prairie. Beaucoup plus loin, au delà du Grand Canal, on aperçoit les coteaux boisés de la Seine qui viennent clore la perspective. Le canal long de près de 1200 m pour 40 m de large, fut creusé à la demande d’Henri IV entre 1606 et 1609. Sa mise en eau, au mois de mai 1609, fut l’objet d’un pari entre le roi et l’un de ses courtisans, le maréchal de Bassompierre qui s'enorgueillit ainsi : « Le roi gagea mille écus, contre moi, que dans deux jours il serait rempli, et il ne le fut même pas en huit. » On imagine que le roi eut tout de même la patience d'attendre la fin du remplissage pour commencer à profiter de joies de la navigation.
Nous nous enfonçons sous la conduite de Didier dans le "Parc de la Grande Prairie" planté initialement de plus de soixante mille arbres où croissaient les rangées de peupliers blancs, les chênes et les arbres fruitiers. Il est parcouru d’allées en étoile. Nous atteignons ainsi l'extrémité nord-est du Domaine au niveau de la Porte Blanche. Nous rejoignons l'extrémité du Grand Canal fermé par un large 🔰endiguement et remontons la belle allée qui longe sa berge sud jusqu'à la rue des Cascades.
Nous nous enfonçons sous la conduite de Didier dans le "Parc de la Grande Prairie" planté initialement de plus de soixante mille arbres où croissaient les rangées de peupliers blancs, les chênes et les arbres fruitiers. Il est parcouru d’allées en étoile. Nous atteignons ainsi l'extrémité nord-est du Domaine au niveau de la Porte Blanche. Nous rejoignons l'extrémité du Grand Canal fermé par un large 🔰endiguement et remontons la belle allée qui longe sa berge sud jusqu'à la rue des Cascades.
Il ne nous reste plus que quelques dizaines de mètres à parcourir pour retrouver nos véhicules. Nous ne reprendrons la route qu'après avoir adressé un grand merci à Didier, pour la bonne organisation de cette rando et la qualité de la documentation réunie pour nous donner quelques repères dans l'histoire si dense des lieux.
Envoyer un commentaire sur cet article.
 |
| Photo panoramique réalisée par Anfré. |
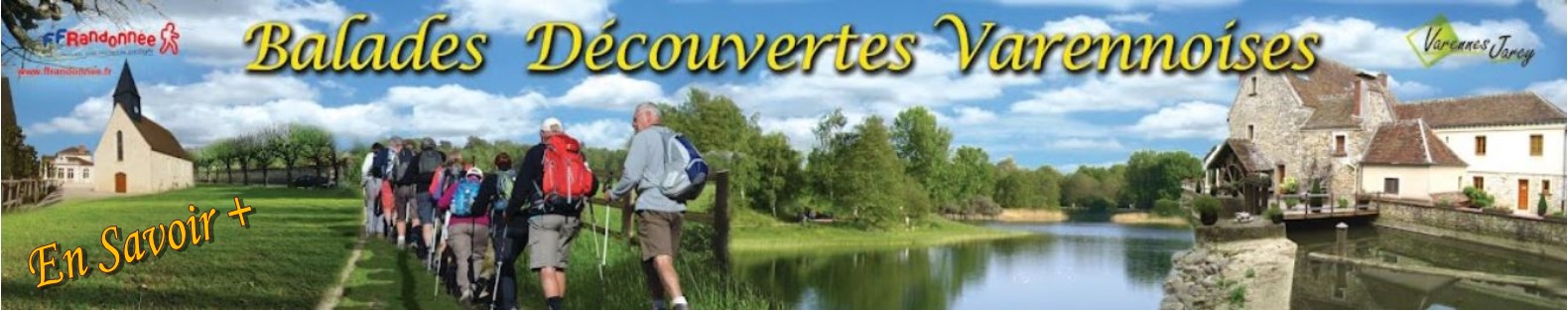
.JPG)
.JPG)


.JPG)
%20(1280x853).jpg)

%20(1280x853).jpg)







.JPG)



.JPG)
.JPG)
