Éric, notre chauffeur semble toujours de bonne humeur. Il nous attend, au volant de son car sur le parking du gymnase pour nous conduire, à l'initiative de Didier, sur les terres de la Champagne Crayeuse à la découverte du Lac d'Orient et du centre médiéval de la bonne ville de Troyes. Le ciel est bleu, le soleil matinal est encourageant. La route défile, monotone à travers l'immensité des paysages agricoles de la Brie champenoise. Nous nous offrons une petite 🔰pause café/croissant sur une aire de la A5 ; un petit vent frisquet nous invite à fermer les manteaux. Didier annonce le programme : la matinée sera consacrée à une courte rando de 5,7 km à Mesnil-Saint-Père, petit village au bord du grand lac d'Orient puis Éric nous embarquera, à 25 km de là, en plein centre de Troyes, où nous déjeunerons au Grill Saint-Jean avant de rencontrer Sabine, guide conférencière, qui nous conduira dans le labyrinthe des ruelles et de l'histoire de la vieille cité.
Le car nous dépose sur un parking tout près de la rive du lac. Nous enfilons nos chaussures de rando ; nous voilà prêts à mettre en œuvre l'alléchant programme de cette belle journée.
Les photos qui illustrent ce compte rendu sont l'œuvre de Didier.
👉Passez la souris sur les petits symboles 🔰 pour ouvrir d'autres photos. (Puis cliquez sur la photo pour la masquer.) Passez la souris sur le symbole🔰 pour ouvrir une photo. Puis cliquez sur la photo pour la masquer.
Les Lacs de la Forêt d'Orient.
Nous marchons sur la longue plage de sable entre le lac et les nombreuses installations consacrées aux activités nautiques. Un nageur s'entraîne dans un crawl bien maîtrisé, un 🔰windsurfer s'élance sous nos yeux ; le vent plutôt affirmé lui permet d'atteindre rapidement une belle vitesse. Au loin, sur l'immense étendue du lac, on aperçoit des voiliers, des planchiste, des rameurs... Des campings, des hôtels, des restaurants se succèdent au long de la rive. De nombreux voiliers sont à l'attache dans le petit port. Ce lac constitue, à n'en pas douter, un important complexe de loisirs.
Le lac d'Orient avec ses 23 km2 est le troisième plus grand lac artificiel de France. Un ingénieur parisien, Henry Chabal avait vu, dès 1918, l’intérêt géologique du secteur. La présence d’un sous-sol chargé d’argile homogène, épaisse et dense offrant tous les avantages. Ce n'est qu'en 1966 que ce lac réservoir fut mis en service. Il a un double rôle :
- Du 1er novembre au 30 juin, l'eau est prélevée dans la Seine, à l'aide d'un canal d'amenée long de 13 km, alors que le fleuve est à son plus haut niveau. Lors des crues, une quantité d'eau supplémentaire est prélevée afin de les atténuer, c'est "l'écrêtement des crues"».
- À partir du 1er juillet et jusqu'au 31 octobre, l'eau est rendue à la Seine lorsqu'elle est à son niveau le plus bas. Cette action s'appelle le "soutien d'étiage". La restitution de ces eaux se fait grâce à un canal de restitution de 27 km, appelé le "canal de la Morge".
Le 1er novembre, il ne reste ainsi dans le lac, plus que 18,6 millions de m3, représentant la "tranche morte" (niveau d'eau essentiel à la survie des poissons). Tous les dix ans, une vidange exceptionnelle est réalisée pour la vérification des ouvrages d'art. À cette occasion, il est possible de voir les constructions immergées lors de la mise en eau (anciennes digues d'étangs, ruines des briqueteries, etc.), mais aussi les détritus que certaines personnes y abandonnent.
Christine demande "Pourquoi dit-on les lacs de la Forêt d'Orient, au pluriel ? Y-en-aurait-il plusieurs ?". En effet, dans les années 80, deux autres lacs reliés par un canal de jonction ont été créés au nord-est du lac d'Orient pour réguler le cours de l'Aube : le lac Armance et le Lac de Temple. Ces trois lacs sont rassemblés sous la dénomination plurielle "Lacs de la Forêt d'Orient".
Enfin, pour être complet, il faut citer le Lac de Pannecière, le plus ancien réservoir, mis en service dès 1949 sur l'Yonne et le Lac du Der-Chantecoq, le plus grand de tous les réservoirs, établi sur la Marne. Ces cinq lacs sont gérés par l'établissement public territorial de bassin "Seine Grands Lacs" dont la mission est d'écrêter les crues d'hiver de la Seine.
Mesnil-Saint-Père.
Nous quittons la rive du grand lac pour rejoindre le centre du village de Mesnil-Saint-Père. La création de l'immense lac réservoir a bien entendu bouleverser le destin de cette petite commune. Trois tuileries, dont l'origine remonte aux Comtes de Champagne, étaient encore en fonctionnement pendant la construction du lac qui les a englouties Elles produisaient des tuiles émaillées de couleurs très variées, biseautées afin que le vent n’ait aucune prise et vernissées pour éviter l’envahissement de la mousse. Elles subsistent à Troyes sur les toitures de l’église Saint Nizier, de celle de Pont-Sainte-Marie et de l’Hôtel Marisy. Une poterie et une faïencerie disparurent également.
Enfin, pour être complet, il faut citer le Lac de Pannecière, le plus ancien réservoir, mis en service dès 1949 sur l'Yonne et le Lac du Der-Chantecoq, le plus grand de tous les réservoirs, établi sur la Marne. Ces cinq lacs sont gérés par l'établissement public territorial de bassin "Seine Grands Lacs" dont la mission est d'écrêter les crues d'hiver de la Seine.
Mesnil-Saint-Père.
Nous quittons la rive du grand lac pour rejoindre le centre du village de Mesnil-Saint-Père. La création de l'immense lac réservoir a bien entendu bouleverser le destin de cette petite commune. Trois tuileries, dont l'origine remonte aux Comtes de Champagne, étaient encore en fonctionnement pendant la construction du lac qui les a englouties Elles produisaient des tuiles émaillées de couleurs très variées, biseautées afin que le vent n’ait aucune prise et vernissées pour éviter l’envahissement de la mousse. Elles subsistent à Troyes sur les toitures de l’église Saint Nizier, de celle de Pont-Sainte-Marie et de l’Hôtel Marisy. Une poterie et une faïencerie disparurent également.
Toute cette petite industrie tenait à la qualité des argiles du sous-sol et paradoxalement, c'est la présence de la couche profonde de cette même argile qui justifiera la création du grand réservoir ; l'argile qui en avait fait la fortune en aura finalement provoqué la ruine.
Trois fermes, la forêt de Larivour et la voie ferrée disparurent également sous les eaux. 180 tombes du petit cimetière furent transférées. Ainsi, encore aujourd’hui, perdure dans les esprits l’idée amère que seuls les parisiens tirent bénéfice de la création du lac, alors qu'en réalité, c’est bien l’ensemble du territoire aval des lacs (dont Troyes) qui en est bénéficiaire.
Didier nous propose de suivre un sentier de petite randonnée, le
🔰sentier du Lapin Blanc,
un circuit conçu pour découvrir différents aspects de ce coquet village très fleuri. Mesnil-Saint-Père est la seule commune de l'Aube reconnue "commune touristique" par arrêté préfectoral et ce depuis plus de 25 ans. Cette distinction est le fruit du soin apporté à l'entretien et à la qualité du patrimoine bâti, de ses
🔰maisons à pans de bois,
la mairie en étant un parfait exemple avec sa façade à pans de bois rose et grise redonnant tout l’éclat à la structure apparente de la bâtisse.
Un obélisque portant le coq gaulois et la croix de guerre, commémore les victimes de la première guerre mondiale. Dans l’impasse des Martyrs, se dresse un second 🔰monument aux morts. Il commémore les 24 fusillés mesnilois, le 28 août 1944 , en représailles de la libération. À l'image de la veuve, de la mère, et de toutes les femmes qui ont perdu des hommes, la statue d'une femme pleurant ces 24 jeunes hommes morts se dresse sur le monument ; l'auteur du monument est inconnu mais il a su rendre l’émotion de cet évènement tragique dans la sobriété du traitement du vêtement de la femme et la douceur de son geste de recueillement.
Un obélisque portant le coq gaulois et la croix de guerre, commémore les victimes de la première guerre mondiale. Dans l’impasse des Martyrs, se dresse un second 🔰monument aux morts. Il commémore les 24 fusillés mesnilois, le 28 août 1944 , en représailles de la libération. À l'image de la veuve, de la mère, et de toutes les femmes qui ont perdu des hommes, la statue d'une femme pleurant ces 24 jeunes hommes morts se dresse sur le monument ; l'auteur du monument est inconnu mais il a su rendre l’émotion de cet évènement tragique dans la sobriété du traitement du vêtement de la femme et la douceur de son geste de recueillement.
Nous marquons un arrêt devant la petite église Saint-André. Elle témoigne de la vie de Mesnil-Saint-Père à différentes époques : Le XIIe siècle où elle fut bâtie, toutefois, l’église actuelle date du XVIe siècle, sa tour-clocher a vraisemblablement été rebâtie au XVIIe siècle. Son état actuel correspond à des modifications effectuées au XIXe et au XXe siècle ce qui explique les baies modernes que présente la nef.. Elle est aujourd’hui en partie bâchée pour cause de travaux et fermée au public pour des raisons de sécurité mais il est toujours possible de l’admirer de l’extérieur. Elle est inscrite depuis 1982 à l’inventaire des monuments historiques.
Nous poursuivons sur le sentier du Lapin Blanc. Nous admirons le soin apporté dans la remise en valeur d'anciens corps de ferme reconvertis en résidence de caractère. Nous continuons sur des sentiers naturels extérieurs au village. Un platelage quelque peu vermoulu recouvert d'un grillage de protection permet de franchir à pied sec un passage marécageux. Plus loin, Didier marque une pause pour indiquer que nous nous trouvons précisément à l'endroit où furent fusiller les 24 hommes victimes de la barbarie nazie aux abois quand le territoire fut sur le point d'être libéré.
Nous retrouvons la route du lac. Le car nous attend sur le Parking d'un hôtel. Nous nous débarrassons de nos chaussures de rando et embarquons, direction Troyes, son centre ville et ses réjouissantes tavernes.
Troyes.
Le car nous dépose sur la Place du Maréchal Foch, toujours très animée le samedi. Nous nous arrêtons un instant pour constater qu'au fronton de la Mairie la 🔰devise républicaine. s'est enrichie de quelques concepts forts, "Unité Indivisibilité de la République Liberté Égalité Fraternité ou la Mort". En ces temps de fraternité mollassonne, de haine banalisée et d'égalité refusée, cette symbolique républicaine intransigeante s'impose de nouveau à l'ordre du jour. Nous nous engageons dans la Rue Champeaux où se succèdent les terrasses des restaurants. Une joyeuse clientèle s'y précipite. L'enseigne de notre restaurant fait référence au nom de l'Église Saint-Jean-au-Marché' toute proche. Au Grill Saint-Jean un menu typiquement troyen nous est proposé avec coupe de champagne et andouillette AAAAA. Le label 5A, non officiel, est une incontestable garantie de qualité pour les professionnels du secteur et les consommateurs. Chroniqueurs, gastronomes professionnels des métiers de bouche réunis dans l’Association Amicale des Amateurs d’Andouillettes Authentiques, lors de dégustations à l’aveugle, signalent, depuis la fin des années 60, avec le sigle "AAAAA" les andouillettes jugées de qualité gustative supérieure.
Nous sortons du restaurant devant lequel Sabine, notre guide nous attend. Jacques croit reconnaître en elle la même personne qui nous avait guidés à Troyes, il y a 12 ans en septembre 2012. On vérifie les photos du Blog prises à l'époque. Pas de doute, c'est bien la même personne. Coup de chapeau à Jacques pour cet exploit de mémoire.
Sabine explique le cadre de son intervention. Nous resterons dans le centre ville. La forme du centre ville de Troyes, définie autrefois par les remparts du XIIIe siècle, ressemble à celle d’un
🔰"bouchon de Champagne".
Les Troyens n'emploient pas l'expression "centre ville". À la place, ils utilisent familièrement l'expression " Bouchon de Champagne" ou simplement "Bouchon". "La Tête" désigne la partie nord du Bouchon. "Le Corps" désigne sa partie sud.
Sabine attire notre attention, à l'angle de la Rue Paillot de Montabert et de la Rue Chardonnet, sur une maison en pierres qui illustre parfaitement la technique du 🔰damier champenois : les murs sont maçonnés en une savante alternance de briquettes rouges et de moellons de craie blanche, la pierre régionale. La craie souvent humide s'assèche au contact de la brique poreuse qui joue comme un drain. Le bâtiment se trouve ainsi à l'abri d'une humidité excessive.
Sabine nous entraîne à présent dans le 🔰petit jardin de l'Église Sainte-Madeleine. Implanté sur un ancien cimetière, on l'appelle le Jardin des Innocents. Des arceaux de fer ont été disposés pour permettre au visiteur de mieux se représenter la forme de la galerie de pierre qui encadrait le jardin. Sabine nous apprend que ces arcs de pierre supportaient les ossements entassés des morts de la paroisse en une sorte de catacombe locale. Les végétaux aux couleurs prédominantes verte et blanche, symbolisent l'éternité, la pureté et la sagesse.
Nous pénétrons dans l'église ; c'est la plus ancienne église de Troyes ; d'architecture gothique elle a été bâtie au XIIe siècle pour la nef, reconstruite au XVIe siècle pour le chœur et l'abside et au XVIIe siècle pour la tour. Nous tombons sous le charme du splendide jubé, prouesse architecturale témoignant d'une époque prospère où les riches paroissiens issus de la noblesse de robe mettaient tout en œuvre pour embellir leur église. Ce jubé, organisé autour de trois arcs brisés festonnés, a pour fonction de séparer les laïcs réunis dans la nef des membres du clergé réunis dans le chœur. Il s’appuie sur deux piliers ornés de riches compositions gothiques. Un escalier latéral permet d’atteindre la galerie ajourée, faite de fleurs de lys couronnées et de trilobes flamboyants. Le jubé a perdu en grande partie sa polychromie. Seuls les deux drapés de pierre, sur la face intérieure des piliers, donnent une idée de ses couleurs originelles. Sabine nous explique l'origine du mot "jubé" : le lecteur, perché sur la structure, commençait son propos par la formule latine "jube, domine, benedicere" ("daigne, Seigneur, me bénir"). On a retenu le mot "jubé" pour désigner la place d'où la formule était prononcée.
Nous nous attardons maintenant devant la statue de Sainte Marthe par le Maître de Chaource, un sculpteur troyen du XVIe siècle resté anonyme ; on le connaît aussi sous le nom de "Maître aux figures tristes". Sabine insiste sur la grande qualité de l'œuvre, la précision des traits, la simplicité apparente des plissés. La sculpture champenoise, et plus particulièrement celle du foyer troyen, a atteint entre le XIVe et la fin du XVIe siècle un niveau exceptionnel, parmi les grands lieux de création de l'Europe. Ce courant artistique va progressivement faire place au style de la Renaissance italienne illustré dans l'église par la statue de 🔰la Vierge de Piété en place sur le jubé au style beaucoup plus maniéré, aux plissés quelque peu exubérants.
Sabine resitue, pour nous, la cité dans son cadre historique. L’occupation du site de Troyes remonte à la préhistoire, mais les premiers à avoir laissé des traces tangibles de leur présence sont les « Tricasses », tribu gauloise qui accepta l’occupation romaine dans le site qui devint alors Augustobona. La cité bénéficiait déjà d’une situation de carrefour, proche de la Seine et reliée à la voie d’Agrippa allant de Milan à Boulogne sur Mer.
Mais ce sont incontestablement les Foires de Champagne qui, au Moyen-Âge, contribuèrent au rayonnement international de la cité. Les Comtes de Champagne, notamment Thibaut II, surent impulser une nouvelle dynamique commerciale avec ces foires de Champagne qui se structurent réellement à la fin du XIIe siècle. Elles se tenaient dans les villes de Lagny-sur-Marne (une fois par an), Provins (deux fois par an), Troyes (deux fois par an) et Bar-sur-Aube (une fois par an). A Troyes, la foire « chaude » de la Saint-Jean débute le 24 juin et celle de la Saint-Rémy, la foire « froide », le 1er octobre durant quinze jours dans le quartier de Saint-Jean, dont l’église est flanquée de logettes accueillant les marchands venant de toute l’Europe (d’où son nom de "Saint-Jean au Marché"). Les foires de Champagne eurent un immense rayonnement international, permettant aux marchands et aux acheteurs de toute l'Europe de s'y retrouver à intervalles réguliers pour y faire commerce. Des marchands de toutes les régions de la France actuelle s'y retrouvent avec leurs homologues de Flandre, d'Italie du Nord, d'Espagne, d'Angleterre, d'Allemagne ou de Suisse.
Les foires de Champagne apportèrent une contribution décisive à la "Révolution Commerciale", qui progressivement fit basculer le monde médiéval vers la Renaissance.
La Renaissance est une période glorieuse pour Troyes, qui devint alors la 5ème ville du royaume grâce au commerce florissant, aux industries textiles, tanneries, papeteries et imprimeries implantées. Les moulins sont reconstruits, les églises agrandies ou rénovées. De plus, la prospérité est remarquable dans le domaine des arts, tant sur le plan architectural qu’artistique grâce aux sculptures et vitraux. Cependant, le 24 mai 1524, un effroyable incendie détruit le tiers de la ville : 1500 maisons sont incendiées ainsi que les églises Saint-Nicolas, Saint-Pantaléon, Saint-Jean au marché.
Cela ne brisa pas le dynamisme de l'époque ; de nouvelles rues furent créées et de nombreuses maisons à pan de bois et des hôtels particuliers en pierre caractérisés par le "damier champenois" furent érigés.
Ici, à Troyes, quand on parle du « Beau XVIe », on fait allusion à cette période faste de l’histoire où la cité fut un brillant creuset artistique dans des domaines aussi variés que l'architecture, la sculpture, la peinture, la tapisserie, la broderie, l’orfèvrerie ou la peinture sur verre.
Sabine nous apprend qu'à l'origine, la bonneterie est née à Troyes grâce à un règlement qui pour combattre l'oisiveté interdit aux orphelinats de bénéficier de dons. Pour survivre, on mit les enfants au travail sur des métiers à tisser. Ainsi commença l'aventure de la bonneterie. Le 19e siècle correspond à l'âge d’or de la bonneterie. Troyes devient très vite la capitale de la bonneterie et de la maille ; les usines se développent sur les terrains inoccupés des faubourgs, principalement au sud-ouest de la ville. Dans les années 1885 à 1910, en raison de l’introduction du métier Cotton, la productivité atteint des sommets et l'activité bénéficie d'une exceptionnelle renommée internationale. De grandes dynasties d’industriels se sont alors constituées : Valton, Poron, Mauchaufée et Lebocey.
Mais ce sont incontestablement les Foires de Champagne qui, au Moyen-Âge, contribuèrent au rayonnement international de la cité. Les Comtes de Champagne, notamment Thibaut II, surent impulser une nouvelle dynamique commerciale avec ces foires de Champagne qui se structurent réellement à la fin du XIIe siècle. Elles se tenaient dans les villes de Lagny-sur-Marne (une fois par an), Provins (deux fois par an), Troyes (deux fois par an) et Bar-sur-Aube (une fois par an). A Troyes, la foire « chaude » de la Saint-Jean débute le 24 juin et celle de la Saint-Rémy, la foire « froide », le 1er octobre durant quinze jours dans le quartier de Saint-Jean, dont l’église est flanquée de logettes accueillant les marchands venant de toute l’Europe (d’où son nom de "Saint-Jean au Marché"). Les foires de Champagne eurent un immense rayonnement international, permettant aux marchands et aux acheteurs de toute l'Europe de s'y retrouver à intervalles réguliers pour y faire commerce. Des marchands de toutes les régions de la France actuelle s'y retrouvent avec leurs homologues de Flandre, d'Italie du Nord, d'Espagne, d'Angleterre, d'Allemagne ou de Suisse.
Les foires de Champagne apportèrent une contribution décisive à la "Révolution Commerciale", qui progressivement fit basculer le monde médiéval vers la Renaissance.
La Renaissance est une période glorieuse pour Troyes, qui devint alors la 5ème ville du royaume grâce au commerce florissant, aux industries textiles, tanneries, papeteries et imprimeries implantées. Les moulins sont reconstruits, les églises agrandies ou rénovées. De plus, la prospérité est remarquable dans le domaine des arts, tant sur le plan architectural qu’artistique grâce aux sculptures et vitraux. Cependant, le 24 mai 1524, un effroyable incendie détruit le tiers de la ville : 1500 maisons sont incendiées ainsi que les églises Saint-Nicolas, Saint-Pantaléon, Saint-Jean au marché.
Cela ne brisa pas le dynamisme de l'époque ; de nouvelles rues furent créées et de nombreuses maisons à pan de bois et des hôtels particuliers en pierre caractérisés par le "damier champenois" furent érigés.
Ici, à Troyes, quand on parle du « Beau XVIe », on fait allusion à cette période faste de l’histoire où la cité fut un brillant creuset artistique dans des domaines aussi variés que l'architecture, la sculpture, la peinture, la tapisserie, la broderie, l’orfèvrerie ou la peinture sur verre.
Sabine nous apprend qu'à l'origine, la bonneterie est née à Troyes grâce à un règlement qui pour combattre l'oisiveté interdit aux orphelinats de bénéficier de dons. Pour survivre, on mit les enfants au travail sur des métiers à tisser. Ainsi commença l'aventure de la bonneterie. Le 19e siècle correspond à l'âge d’or de la bonneterie. Troyes devient très vite la capitale de la bonneterie et de la maille ; les usines se développent sur les terrains inoccupés des faubourgs, principalement au sud-ouest de la ville. Dans les années 1885 à 1910, en raison de l’introduction du métier Cotton, la productivité atteint des sommets et l'activité bénéficie d'une exceptionnelle renommée internationale. De grandes dynasties d’industriels se sont alors constituées : Valton, Poron, Mauchaufée et Lebocey.
Nous arpentons la Rue Champeaux où s'alignent de magnifiques maisons à pans de bois et à encorbellement. Sabine donne quelques explications sur leur architecture. L'encorbellement consiste à établir l'étage sur des corbeaux débordant le rez de chaussée. Cette technique avait deux avantages ; accroître la surface sans payer l'impôt calculé sur la seule emprise au sol et abriter, par le couvert de l'encorbellement, les marchandises exposées à l'étal des petites boutiques au pied des maisons.
Sabine attire notre attention sur le fait que le verre était rare et cher au XVIe siècle et que les baies des maisons étaient le plus souvent occultées par des panneaux de bois. Au niveau des combles sous toiture, le pignon est souligné par les fermes d’avant-corps. Le grand pignon auvent est protégé par un tuilage harmonieux de ce qu'on appelle ici des essentes (tavaillons dans le Jura). Il abrite la façade des intempéries. Les toitures donnent une belle allure élancée aux façades. Les sablières, grosses poutres horizontales à la base de chaque étage, sont sculptées et rainurées de telle sorte que les eaux de pluie s'en égouttent avant d'infiltrer les mortiers et torchis qui remplissent les espaces entre les pans de bois. Sablières et pans de bois sont assemblés par tenon et mortaise. "Ni clou, ni vis" s'amuse à dire Sabine pour étayer son propos. À l'angle de la rue Champeaux et la Rue Paillot de Montabert, une tourelle, joliment décorée par un damier d'essentes en losange est surmontée par un toit conique en ardoises.
Entre 1945 et 1990, nous informe Sabine, la politique de rénovation urbaine a entraîné de nombreuses démolitions des îlots anciens de la ville de Troyes, considérés comme insalubres. Détruire les taudis a été une politique française incarnée par la loi du 7 août 1957. L’objectif était de détruire, en dix ans, les 450 000 taudis recensés en 1954. On voulait faire table rase de ces quartiers vétustes pour reconstruire du neuf. À cette époque, la remise en état des logements anciens n’est défendue par personne. Olivier Denert, dans son mémoire consacré à la politique du patrimoine à Troyes, estime qu’entre 1945 à 1985, le "Bouchon de Champagne" a perdu un quart de ses maisons à pan de bois.
Le quartier Saint-Jean échappa au pire grâce à la création d'un secteur sauvegardé fondé sur la reconnaissance des valeurs patrimoniales. André Malraux s'était alarmé de la menace. La loi, qui porte son nom , pour la sauvegarde du patrimoine ancien est adoptée le 4 août 1962.
Il n'en reste cependant pas moins que la moitié des maisons restaurées de la rue Paillot-de-Montabert, située dans ce quartier et jouant le rôle de vitrine touristique de Troyes, ne sont plus de vraies maisons à pan de bois. Elles n'en possèdent que les façades. Il s’agit dans la plupart des cas de façades sauvegardées, apposées devant des structures modernes. Il s’agit aussi du réemploi des anciens pans de bois provenant des quartiers démolis : par exemple, les pans de bois de la façade du 18 de la rue proviennent de l’îlot Camusat qui fut rasé.
Sabine attire notre attention sur le fait que le verre était rare et cher au XVIe siècle et que les baies des maisons étaient le plus souvent occultées par des panneaux de bois. Au niveau des combles sous toiture, le pignon est souligné par les fermes d’avant-corps. Le grand pignon auvent est protégé par un tuilage harmonieux de ce qu'on appelle ici des essentes (tavaillons dans le Jura). Il abrite la façade des intempéries. Les toitures donnent une belle allure élancée aux façades. Les sablières, grosses poutres horizontales à la base de chaque étage, sont sculptées et rainurées de telle sorte que les eaux de pluie s'en égouttent avant d'infiltrer les mortiers et torchis qui remplissent les espaces entre les pans de bois. Sablières et pans de bois sont assemblés par tenon et mortaise. "Ni clou, ni vis" s'amuse à dire Sabine pour étayer son propos. À l'angle de la rue Champeaux et la Rue Paillot de Montabert, une tourelle, joliment décorée par un damier d'essentes en losange est surmontée par un toit conique en ardoises.
Entre 1945 et 1990, nous informe Sabine, la politique de rénovation urbaine a entraîné de nombreuses démolitions des îlots anciens de la ville de Troyes, considérés comme insalubres. Détruire les taudis a été une politique française incarnée par la loi du 7 août 1957. L’objectif était de détruire, en dix ans, les 450 000 taudis recensés en 1954. On voulait faire table rase de ces quartiers vétustes pour reconstruire du neuf. À cette époque, la remise en état des logements anciens n’est défendue par personne. Olivier Denert, dans son mémoire consacré à la politique du patrimoine à Troyes, estime qu’entre 1945 à 1985, le "Bouchon de Champagne" a perdu un quart de ses maisons à pan de bois.
Le quartier Saint-Jean échappa au pire grâce à la création d'un secteur sauvegardé fondé sur la reconnaissance des valeurs patrimoniales. André Malraux s'était alarmé de la menace. La loi, qui porte son nom , pour la sauvegarde du patrimoine ancien est adoptée le 4 août 1962.
Il n'en reste cependant pas moins que la moitié des maisons restaurées de la rue Paillot-de-Montabert, située dans ce quartier et jouant le rôle de vitrine touristique de Troyes, ne sont plus de vraies maisons à pan de bois. Elles n'en possèdent que les façades. Il s’agit dans la plupart des cas de façades sauvegardées, apposées devant des structures modernes. Il s’agit aussi du réemploi des anciens pans de bois provenant des quartiers démolis : par exemple, les pans de bois de la façade du 18 de la rue proviennent de l’îlot Camusat qui fut rasé.
Sabine attire notre attention, à l'angle de la Rue Paillot de Montabert et de la Rue Chardonnet, sur une maison en pierres qui illustre parfaitement la technique du 🔰damier champenois : les murs sont maçonnés en une savante alternance de briquettes rouges et de moellons de craie blanche, la pierre régionale. La craie souvent humide s'assèche au contact de la brique poreuse qui joue comme un drain. Le bâtiment se trouve ainsi à l'abri d'une humidité excessive.
Sabine nous entraîne à présent dans le 🔰petit jardin de l'Église Sainte-Madeleine. Implanté sur un ancien cimetière, on l'appelle le Jardin des Innocents. Des arceaux de fer ont été disposés pour permettre au visiteur de mieux se représenter la forme de la galerie de pierre qui encadrait le jardin. Sabine nous apprend que ces arcs de pierre supportaient les ossements entassés des morts de la paroisse en une sorte de catacombe locale. Les végétaux aux couleurs prédominantes verte et blanche, symbolisent l'éternité, la pureté et la sagesse.
Nous pénétrons dans l'église ; c'est la plus ancienne église de Troyes ; d'architecture gothique elle a été bâtie au XIIe siècle pour la nef, reconstruite au XVIe siècle pour le chœur et l'abside et au XVIIe siècle pour la tour. Nous tombons sous le charme du splendide jubé, prouesse architecturale témoignant d'une époque prospère où les riches paroissiens issus de la noblesse de robe mettaient tout en œuvre pour embellir leur église. Ce jubé, organisé autour de trois arcs brisés festonnés, a pour fonction de séparer les laïcs réunis dans la nef des membres du clergé réunis dans le chœur. Il s’appuie sur deux piliers ornés de riches compositions gothiques. Un escalier latéral permet d’atteindre la galerie ajourée, faite de fleurs de lys couronnées et de trilobes flamboyants. Le jubé a perdu en grande partie sa polychromie. Seuls les deux drapés de pierre, sur la face intérieure des piliers, donnent une idée de ses couleurs originelles. Sabine nous explique l'origine du mot "jubé" : le lecteur, perché sur la structure, commençait son propos par la formule latine "jube, domine, benedicere" ("daigne, Seigneur, me bénir"). On a retenu le mot "jubé" pour désigner la place d'où la formule était prononcée.
Nous nous attardons maintenant devant la statue de Sainte Marthe par le Maître de Chaource, un sculpteur troyen du XVIe siècle resté anonyme ; on le connaît aussi sous le nom de "Maître aux figures tristes". Sabine insiste sur la grande qualité de l'œuvre, la précision des traits, la simplicité apparente des plissés. La sculpture champenoise, et plus particulièrement celle du foyer troyen, a atteint entre le XIVe et la fin du XVIe siècle un niveau exceptionnel, parmi les grands lieux de création de l'Europe. Ce courant artistique va progressivement faire place au style de la Renaissance italienne illustré dans l'église par la statue de 🔰la Vierge de Piété en place sur le jubé au style beaucoup plus maniéré, aux plissés quelque peu exubérants.
On dit que quatre vitraux sur dix à travers le monde se trouvent dans l’Aube.... Nulle part ailleurs en tout cas on ne rencontre une telle concentration et une telle qualité de verrières. Entre 1480 et 1850, Troyes s’impose comme un foyer artistique de premier plan où émergent une trentaine de peintres verriers. Leur style est homogène, fait de couleurs vives, chaudes et contrastées. Certains historiens n’hésiteront pas à parler d’une "école troyenne" de la peinture sur verre.
Sabine nous apporte d'abondantes explications sur les magnifiques verrières de l'église aussi bien sur les techniques de réalisation à partir de verre soufflé que sur les thématiques abordées ici : un arbre de Jessé, une vie de Eloi, une passion, un calvaire, une vie de Madeleine...Certains détails étonnants sont soulignés comme la représentation d'un minuscule éléphant près d'un cheval géant dans un élément de vitrail traitant de l'Arche de Noé.
D'autres groupes de visiteurs se présentent dans l'église. Nous laissons la place.
Sabine nous conduit maintenant dans le Jardin Juvenal-des-Ursins, un jardin très contemporain réalisé sur le modèle médiéval des jardins de simples.
Ici, les buis ne semblent avoir souffert de l'attaque désastreuse de la pyrale. Les 🔰belles maisons modernes qui encadrent le jardin reproduisent avec succès le charme des maisons à pans de bois du "Bouchon". L'ensemble maisons et jardin constitue une incontestable réussite architecturale.
D'autres groupes de visiteurs se présentent dans l'église. Nous laissons la place.
Sabine nous conduit maintenant dans le Jardin Juvenal-des-Ursins, un jardin très contemporain réalisé sur le modèle médiéval des jardins de simples.
Ici, les buis ne semblent avoir souffert de l'attaque désastreuse de la pyrale. Les 🔰belles maisons modernes qui encadrent le jardin reproduisent avec succès le charme des maisons à pans de bois du "Bouchon". L'ensemble maisons et jardin constitue une incontestable réussite architecturale.
Nous voici maintenant dans l'incontournable ruelle des Chats. On l'appelle ainsi parce qu'un chat peut passer d'un côté à l'autre de la rue, en passant par les toits. Les façades se touchent par le sommet, et sont maintenues par des étais. Gabriel Groley, historien troyen, constate : « Les charpentiers troyens savaient tout de même bien calculer l'équilibre de leurs pièces de bois pour qu'une déviation de cette importance ne cause aucune crainte justifiée ».
Très étroite, cette ruelle donne une idée des rues médiévales pavées avec une rigole centrale pour l'écoulement des eaux. Les lourdes pierres situées de part et d'autre de la venelle servaient aux piétons à se protéger du passage des chariots tirés par les chevaux. Elles sont l'ancêtre des trottoirs.
En 1789, François-Nicolas Sourdat, lieutenant général de police, notait que "l'étroit passage de la ruelle donne lieu à des rendez-vous et occasionne des désordres de libertinage". Au n°25 de la ruelle des Chats, la belle maison à pans de bois verts fut construite au XVIe s. pour Pierre Mauroy, seigneur de Colaverdey, maire de Troyes de 1517 à 1521.
À l'angle de la ruelle des Chats, au niveau de l'élargissement de la ruelle, se trouve la Cour du mortier d'Or où nous conduit Sabine. C'est une petite cour typique de Troyes, disposant d’un puits et d’une façade à pans, où poutre contemporaine et poutre de l’époque moderne se mêlent.
Très étroite, cette ruelle donne une idée des rues médiévales pavées avec une rigole centrale pour l'écoulement des eaux. Les lourdes pierres situées de part et d'autre de la venelle servaient aux piétons à se protéger du passage des chariots tirés par les chevaux. Elles sont l'ancêtre des trottoirs.
En 1789, François-Nicolas Sourdat, lieutenant général de police, notait que "l'étroit passage de la ruelle donne lieu à des rendez-vous et occasionne des désordres de libertinage". Au n°25 de la ruelle des Chats, la belle maison à pans de bois verts fut construite au XVIe s. pour Pierre Mauroy, seigneur de Colaverdey, maire de Troyes de 1517 à 1521.
À l'angle de la ruelle des Chats, au niveau de l'élargissement de la ruelle, se trouve la Cour du mortier d'Or où nous conduit Sabine. C'est une petite cour typique de Troyes, disposant d’un puits et d’une façade à pans, où poutre contemporaine et poutre de l’époque moderne se mêlent.
Ce qui nous est permis de voir ici, correspond à l’arrière des maisons à pans de bois qui encadrent la petite cour. On admire leurs belles galeries coursives. Les abouts de poutre sont sculptés de sujets d’inspiration souvent guerrière.
Des pilastres sculptés encadrent le passage vers la ruelle des Chats. L’ensemble a été restauré en 1981 par les Compagnons du Devoir.
Sabine nous recommande de consacrer, lors d'une prochain passage à Troyes, un moment à la visite de la Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière, installée dans l'Hôtel Mauroy, non loin de la petite Cour du mortier d'Or. Nous avons bien conscience qu'il reste beaucoup à voir parmi les trésors de cette ville, la basilique Saint-Urbain , l’hôtel de Vauluisant, le musée d’Art Champenois, le musée de la Bonneterie, la Cité du Vitrail ou, plus prosaïquement, les magasins d'usine de Marques Avenue.
Le moment est venu de remercier Sabine pour la qualité de ses commentaires. Notre car nous attend sur le parking du Cube, le parc des expos de la ville.
Nous trouverons un moment sur la route du retour pour féliciter Éric le chauffeur pour son aimable capacité à nous supporter et pour la qualité de son pilotage. Il nous faut enfin vivement remercier Didier pour la parfaite organisation de cette journée si riche en découvertes.
Des pilastres sculptés encadrent le passage vers la ruelle des Chats. L’ensemble a été restauré en 1981 par les Compagnons du Devoir.
Sabine nous recommande de consacrer, lors d'une prochain passage à Troyes, un moment à la visite de la Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière, installée dans l'Hôtel Mauroy, non loin de la petite Cour du mortier d'Or. Nous avons bien conscience qu'il reste beaucoup à voir parmi les trésors de cette ville, la basilique Saint-Urbain , l’hôtel de Vauluisant, le musée d’Art Champenois, le musée de la Bonneterie, la Cité du Vitrail ou, plus prosaïquement, les magasins d'usine de Marques Avenue.
Le moment est venu de remercier Sabine pour la qualité de ses commentaires. Notre car nous attend sur le parking du Cube, le parc des expos de la ville.
Nous trouverons un moment sur la route du retour pour féliciter Éric le chauffeur pour son aimable capacité à nous supporter et pour la qualité de son pilotage. Il nous faut enfin vivement remercier Didier pour la parfaite organisation de cette journée si riche en découvertes.
 |
| Les belles galeries coursives de la Cour du Mortier d'Or. |
RETOUR
Envoyer un commentaire sur cet article.
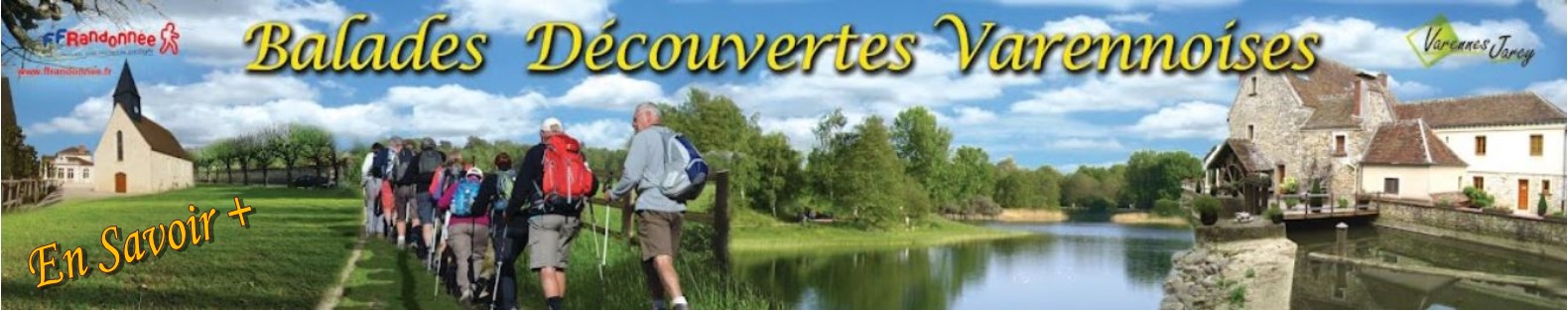
.JPG)




.JPG)
.JPG)





.jpg)





.jpg)





