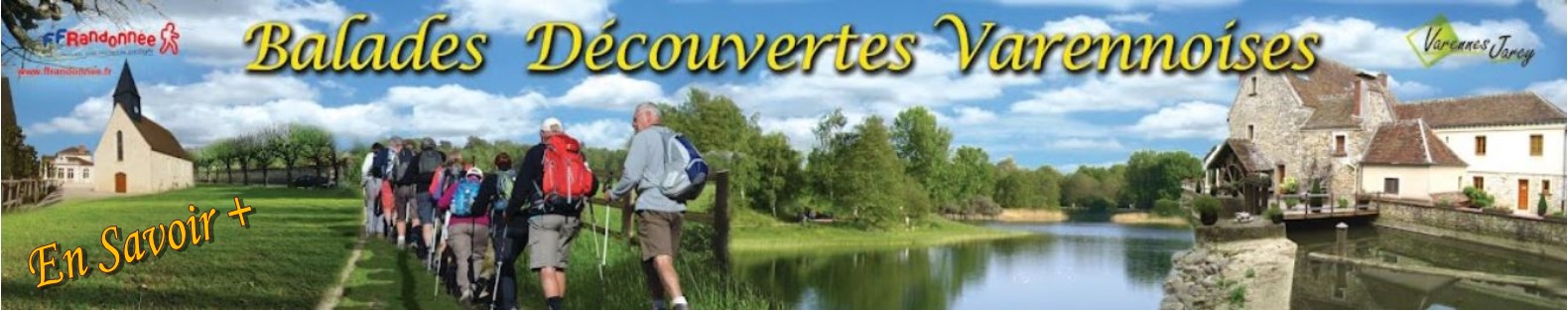Les petits symboles 🔰 permettent d’ouvrir les photos : touchez ou cliquez dessus pour ouvrir, puis à nouveau sur la photo pour la refermer.
Photos du jour.
C'est, aujourd'hui, notre première rando printanière de la saison 2024/2025 et c'est effectivement d'une très belle journée ensoleillée dont nous allons profiter pour suivre Christine sur une boucle de 9 km dans le cadre bucolique et apaisant des grands étangs et des marais de Vert-le-Petit, un petit coin particulièrement privilégié dans la basse vallée de l'Essonne. La température qui frise, aujourd'hui, les 18°C est idéale pour la découverte du site.
Les basses vallées de l'Essonne et de la Juine.
Nous nous sommes garés tout au bout de la ruelle Moutier qui chemine entre deux étangs pour conduire au grand parking du "Chalet des Étangs", un restaurant de très bonne réputation idéalement installé au bord du qui comme son nom ne l'indique pas est en réalité un des cinq beaux étangs de la commune.
Nous nous sommes garés tout au bout de la ruelle Moutier qui chemine entre deux étangs pour conduire au grand parking du "Chalet des Étangs", un restaurant de très bonne réputation idéalement installé au bord du qui comme son nom ne l'indique pas est en réalité un des cinq beaux étangs de la commune.
Nous connaissons bien cette Basse Vallée de l'Essonne, où nous avons eu l'occasion de promener nos guêtres lors de différentes randos, à Mennecy, à Montauger, à Écharcon, à Vert-le-Petit, à Fontenay-le-Vicomte, à Ballancourt, à Cerny, à La Ferté-Allais... (Des randos que nous devons à Didier, à Claude, à Jacques, et à Christine)
La basse vallée de l'Essonne entre Cerny et Corbeil est originellement un immense territoire de marais qui s'étend de part et d'autre du cours de la rivière. Les grands étangs et les marais que nous avons eu le plaisir de découvrir à l'occasion de ces randos sont, en réalité, d'anciennes tourbières qui autrefois firent la richesse des villages (et en tout cas celle de leurs propriétaires). En effet, les rives de l'Essonne, autrefois constituées de prairies et de bois, étaient très régulièrement inondées. Sous l'effet des eaux, la décomposition des différentes espèces végétales a produit au cours des siècles une grande épaisseur de tourbe. Ce type de sol, une fois débarrassé de son eau, peut être utilisé comme combustible. L’exploitation de la tourbe s’est considérablement développée avec l’essor de l’industrie dans les années 1830. Puis, avec la concurrence du charbon et surtout de l’électricité, l'exploitation de ce combustible relativement pauvre s’est progressivement arrêtée. Les profondes carrières de tourbe, laissées à l'abandon, se sont emplies d’eau et ont donné naissance aux étangs de cette vallée remarquable. On imagine l'importance considérable de l'exploitation de la tourbe sur ce secteur.
Aujourd'hui, ces étangs ont une vocation principalement écologique et touristique. Ce sont donc cinq de ces étangs que Christine nous propose de découvrir, les cinq étangs de Vert-le-Petit. Ils s'étendent sous nos yeux sur une surface totale de plus de quarante hectares : le Petit Étang (1,5 ha), le Grand Étang (7 ha), le Marais Communal (8 ha), l'Étang Fleuri(11 ha) et le plus vaste l'Étang à Chat (15 ha).
Nous déambulons sur le sentier de "La Digue de l'Étang Fleuri", un étroit sentier qui s'allonge entre "l'Étang Fleuri" sur notre gauche et l'immense et magnifique "Étang à Chat" sur notre droite.
Des pêcheurs confortablement installés ont déployé leur matériel et patientent à l'affût de la moindre manifestation d'une frétillante présence au bout de leur ligne... En effet, ces eaux possèdent une richesse halieutique de grande notoriété : gardons, rotengles, brèmes, tanches, carpes, sandres et brochets. Ainsi, chaque année, les pêcheurs sont plusieurs milliers à venir pratiquer leur loisir préféré sur les étangs de Vert-le-Petit. Munis d'une autorisation de pêche obligatoire, certains vont même jusqu'à planter la tente pour dormir sur place.
Ces grands plans d'eau nous donnent aussi l'occasion d'observer d'autres habitants des lieux : oies blanches,
cygnes,
poules d’eau, canards, et
qui se tiennent cachées dans les roselières.
Le Marais de Misery.
L'usine du Bouchet.
Philippe m'a interpelé au début de la rando sur un aspect inattendu de l'histoire de Vert-le-Petit qui a revêtu une importance considérable dans notre histoire nationale. En voici un bref résumé en quelques dates :
On aperçoit la terrasse du restaurant "L'Étang Fleury" installée au bord de l'étang du même nom. Nous sommes, ici, au Bouchet, un hameau de Vert-le-Petit. Philippe m'explique que ce minuscule hameau a une importance considérable dans l'histoire de l'armement français et notamment dans l'histoire de notre dissuasion nucléaire. J'ai consacré un chapitre à ce sujet (voir à la fin du Compte-Rendu).
Le sentier qui traverse le petit 'Bois des Plantes' permet de rejoindre le centre ville de Vert-le-Petit. Nous remontons jusqu'à la Place de l'Église, empruntons la Rue de la Liberté au bout de laquelle une belle allée arborée piétonnière, l'Allée de la Cheminée Blanche, conduit jusqu'aux installations sportives, le Gymnase Roger Bambuck puis les stades de Tennis.
Un peu plus loin nous entrons sur le "Chemin de la Croix" qui traverse tout le plateau agricole jusqu'à trouver la route Armand Louis. Nous passons près des installations d'un apiculteur. De
sont disposées le long de l'allée qui y mène. Certains parmi nous se souviennent s'être arrêtés ici, lors d'une précédente rando, pour acheter du miel qu'ils nous disent avoir trouver délicieux.
Nous poursuivons jusqu'au panneau indiquant l'entrée dans la Marais de Misery.
Christine marque un arrêt pour nous dire un mot sur ces lieux. Acquis en 1995 au titre de la politique départementale des Espaces Naturels Sensibles, le Marais de Misery couvre une surface de 88 hectares sur les communes de Vert-le-Petit et Echarcon. Ici, ce ne sont plus de beaux étangs en eau profonde qui s'étendent devant nous mais une vaste zone humide marécageuse. Cette mosaïque de milieux naturels surprenants (vieux boisements humides, saulaies, aulnaies, roselières, prairies…) s'est développée sur ce labyrinthe aquatique de petits étangs, de mares et de chenaux.
Le site du marais offre un intérêt environnemental exceptionnel. Plus de 250 espèces végétales ont été recensées dans cette vaste étendue composée à la fois de champs de roseaux, de vieux boisements humides et de plans d'eau. Paradis des plantes, le marais est également un havre de paix pour les oiseaux : près de 140 espèces y ont été répertoriées. Une soixantaine d'entre elles sont remarquables au plan national et même européen, dont un petit héron devenu très rare en Ile-de-France,
le
Mais cet éden végétal et animal a bien failli disparaître, victime de la pratique anarchique de la chasse ou de la multiplication des cabanons de pêche. "Cinq années de travail ont été nécessaires pour réhabiliter le site", indique-t-on au conseil général. "Il a fallu traiter les étendues d'eau, tailler les massifs de roseaux, mais aussi tracer de nouveaux chemins de randonnée".
Des postes d'observation de la flore et de la faune ont été installés dans le marais. Des panneaux pédagogiques sont à disposition permettant à l'amateur de nature d'identifier les différentes espèces.
Nous rencontrons un chasseur d'images équipé de matériel photographique de pointe. Il nous confie fréquenter ces lieux depuis de nombreuse années et déplore avoir constater une raréfaction des espèces d'oiseau sur les plans d'eau due selon lui à l'importance des dernières crues.
Nous ne tardons pas à rejoindre le cours de l'Essonne, elle-même, que nous suivons jusqu'au installé près du Chalet des Étangs. Nos véhicules nous attendent à deux pas. Un grand merci à Christine pour cette belle rando pour laquelle elle a pris soin de réunir une importante documentation qui m'a été très utile pour écrire le présent compte rendu.
Nous ne tardons pas à rejoindre le cours de l'Essonne, elle-même, que nous suivons jusqu'au installé près du Chalet des Étangs. Nos véhicules nous attendent à deux pas. Un grand merci à Christine pour cette belle rando pour laquelle elle a pris soin de réunir une importante documentation qui m'a été très utile pour écrire le présent compte rendu.
L'usine du Bouchet.
 |
| Le Bouchet en 1961. |
En 1820, une poudrerie est installée dans le village au lieu dit "Le Bouchet" en lieu et place d'un ancien moulin.
En 1866, la poudrerie passe au service de l'Artillerie et devient la "Poudrerie Militaire du Bouchet".
Pendant la guerre de 1914 à 1918, dans l'usine du Bouchet, 5 000 travailleuses et travailleurs produisirent des quantités énormes de poudre et de munitions pour les besoins du front.
De 1920 à 1940, sans pour autant interrompre totalement la fabrication de munitions classiques, l’établissement orienta une grande partie de son activité vers de nouvelles technologies liées à l’hypothèse d’un conflit où seraient mis en œuvre des procédés chimiques, biologiques et bactériologiques. L’emprise des terrains utilisés pour les besoins de la poudrerie et de la station d’essais atteignit cent hectares.
En 1948, le commissariat à l'Énergie atomique (CEA) décide de produire au Bouchet le combustible nucléaire de la pile Zoé, puis de l'uranium métal sous forme de lingots.
En 1866, la poudrerie passe au service de l'Artillerie et devient la "Poudrerie Militaire du Bouchet".
Pendant la guerre de 1914 à 1918, dans l'usine du Bouchet, 5 000 travailleuses et travailleurs produisirent des quantités énormes de poudre et de munitions pour les besoins du front.
De 1920 à 1940, sans pour autant interrompre totalement la fabrication de munitions classiques, l’établissement orienta une grande partie de son activité vers de nouvelles technologies liées à l’hypothèse d’un conflit où seraient mis en œuvre des procédés chimiques, biologiques et bactériologiques. L’emprise des terrains utilisés pour les besoins de la poudrerie et de la station d’essais atteignit cent hectares.
En 1948, le commissariat à l'Énergie atomique (CEA) décide de produire au Bouchet le combustible nucléaire de la pile Zoé, puis de l'uranium métal sous forme de lingots.
En novembre 1949, Bertrand Goldschmidt et ses collaborateurs, Pierre Regnaut, Jean Sauteron et André Chesne réussissent, au Bouchet, l'extraction des premiers milligrammes de plutonium, étape essentielle pour la fabrication de la bombe atomique française.
En 1956, la production d'uranium métal, dans l'usine du Bouchet, atteint un maximum annuel de 500 tonnes de quoi alimenter tous les réacteurs nucléaires français de l'époque.
Dans les années 1960, l'usine du Bouchet reste une usine pilote en ce qui concerne le développement de nouveaux procédés chimiques de traitement de l'uranium. Le Bouchet produit plus de 4 000 tonnes d'uranium métal, notamment pour les réacteurs de recherche et les réacteurs à uranium naturel graphite gaz.
En 1971, le centre du Bouchet est définitivement fermé et le raffinage de l'uranium est désormais assuré en France par la société Comurhex à l'usine de Malvési (Narbonne, Aude).
Se conformant à un arrêté préfectoral, le CEA recouvre le site en 1993 d'argile compactée, de gravier et de terre arable.
En 1956, la production d'uranium métal, dans l'usine du Bouchet, atteint un maximum annuel de 500 tonnes de quoi alimenter tous les réacteurs nucléaires français de l'époque.
Dans les années 1960, l'usine du Bouchet reste une usine pilote en ce qui concerne le développement de nouveaux procédés chimiques de traitement de l'uranium. Le Bouchet produit plus de 4 000 tonnes d'uranium métal, notamment pour les réacteurs de recherche et les réacteurs à uranium naturel graphite gaz.
En 1971, le centre du Bouchet est définitivement fermé et le raffinage de l'uranium est désormais assuré en France par la société Comurhex à l'usine de Malvési (Narbonne, Aude).
Se conformant à un arrêté préfectoral, le CEA recouvre le site en 1993 d'argile compactée, de gravier et de terre arable.