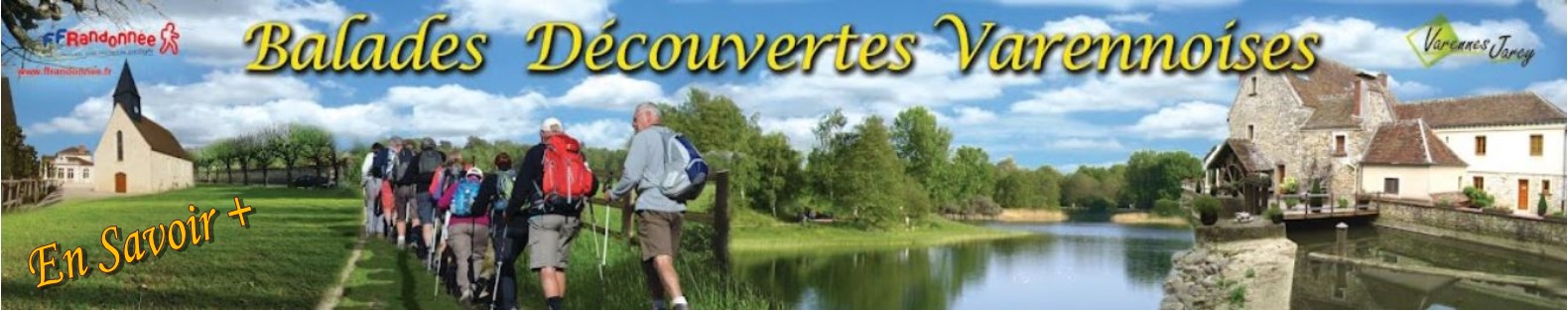|
| Photo D. Armanini (Janvier 2020) |
Place de la Mairie.
Cette place est dominée par un remarquable beffroi et, un peu plus loin, par la flèche élancée du toit de l'église.
Aimé nous donne quelques informations sur ces monuments : À l'endroit où s'élève aujourd'hui le beffroi, se trouvait
🔰l'Église Saint Médard
dont le clocher vétuste a été démoli en 1883. Pour le remplacer, fut élevé, en 1897, ce beffroi municipal chargé de sonner l'angélus offrant ainsi aux ouvriers agricoles, nombreux à l’époque, un indispensable repérage dans le temps. L' ancienne église étant condamnée à terme, une petite chapelle fut construite, dès 1907, sur un terrain voisin appartenant au rosiériste Christophe COCHET. L' ancienne église fut finalement démolie en 1910 malgré une campagne de presse et de pétitions, à laquelle participa l’écrivain de la droite nationaliste Maurice Barrès.
Cinquante ans plus tard, il fallut remplacer la trop petite 🔰Chapelle des Roses . Une association familiale entreprit, de 1964 à 1966, la construction d’une église moderne : Notre-Dame-des-Roses . Antoine Koradi, architecte, opta pur une conception ternaire : toiture à trois angles, trois murs en béton et fenêtres triangulaires. Le toit parabolique couvert d'ardoises, surmonté d'une flèche pyramidale de 42 m, figure une rose renversée.
Aimé nous invite à pénétrer dans l'église ; à
🔰l'intérieur
, la charpente en bois lamellé-collé supporte une voûte lambrissée évoquant la barque des apôtres. A la jonction des murs, le couvrement dessine des baies triangulaires. Celles-ci sont remplies de verrières, dans une armature de plomb, sur le thème des stations du chemin de Croix. Ces vitraux ont été réalisés par le maître verrier Jacques Loire.
Nous nous dirigeons maintenant vers le
🔰lavoir de la Fontaine Houdart
. On le trouve au bout d'une ruelle en impasse sur un terrain envahi par les mauvaises herbes. L'eau du bassin est remarquablement limpide. Nous rebroussons chemin pour rejoindre le Chemin des Guigniers qui permet de franchir le petit ru de la Barbançonne peu avant le Château de Villemain.
 |
| Photo D. Armanini (Janvier 2020) |
Ne pas confondre le mot "Barbançonne" avec son anagramme "Brabançonne", l'hymne national belge.
🎵 Hymne national belge.
Le Château de Villemain.
Aimé nous donne des informations sur cette ancienne seigneurie de style Louis XIII. Au XVIèmesiècle, le château, les jardins et le parc furent la propriété de
🔰Jean Nicot
. Ce diplomate et voyageur érudit passe pour être l'auteur du premier grand corpus de dictionnaires français-latin. Mais il est aussi et surtout connu pour être l'importateur d'une plante aux grandes vertus médicinales : le tabac (qui à cette époque ne se fumait pas encore). L'herbe à Nicot est à l'origine de ce qu'on nomma plus tard "nicotine", cette drogue douce qui a engendré tant de grands malheurs pour le plus grand nombre et quelques immenses fortunes pour quelques uns.
L'histoire moderne du château est lourde d'anecdotes angoissantes. Ce château abritait depuis 1983 "Foi et Pratique", la branche intégriste du Tabligh. Le tabligh (en français "Association pour la prédication") est un mouvement transnational de prédication de masse, né en Inde en 1927.
Son fondateur Muhammas Ilyas prônait une pratique individuelle pure proche de la vie menée par le Prophète, et une interprétation strictement littérale du Coran. En 2004, une enquête avait mené quatre journalistes de Canal+ depuis le Pakistan jusqu'aux portes de cet intrigant château où ils soupçonnaient la présence d'une école coranique clandestine. Mohsen Hammami, avec son père, l'imam Mohammed Hammami et plusieurs jeunes de l'organisation, visiblement irrités par la présence des journalistes, vont violemment les prendre à partie et les passer à tabac.
Depuis la fermeture de l'internat en 2004, il y a très peu de signes d'activité au château. Si l'association "Foi et Pratique" est toujours propriétaire des lieux, les travaux nécessaires à la remise aux normes du bâtiment n'ont pas été effectués et les grilles de la propriété restent closes. Du côté de la mairie, on est formel : «Le château de Villemain n'est plus habité. Il n'y a plus aucun enfant là-bas. Tous sont retournés dans leurs familles et ont été à nouveau scolarisés à l'école républicaine ».
Son fondateur Muhammas Ilyas prônait une pratique individuelle pure proche de la vie menée par le Prophète, et une interprétation strictement littérale du Coran. En 2004, une enquête avait mené quatre journalistes de Canal+ depuis le Pakistan jusqu'aux portes de cet intrigant château où ils soupçonnaient la présence d'une école coranique clandestine. Mohsen Hammami, avec son père, l'imam Mohammed Hammami et plusieurs jeunes de l'organisation, visiblement irrités par la présence des journalistes, vont violemment les prendre à partie et les passer à tabac.
Depuis la fermeture de l'internat en 2004, il y a très peu de signes d'activité au château. Si l'association "Foi et Pratique" est toujours propriétaire des lieux, les travaux nécessaires à la remise aux normes du bâtiment n'ont pas été effectués et les grilles de la propriété restent closes. Du côté de la mairie, on est formel : «Le château de Villemain n'est plus habité. Il n'y a plus aucun enfant là-bas. Tous sont retournés dans leurs familles et ont été à nouveau scolarisés à l'école républicaine ».
Le 23 janvier 2008, l'Imam Hammami , son fils et deux jeunes membres de "Foi et Pratique", ont été condamnés à des peines de prison par le tribunal correctionnel de Melun pour les graves violences infligées, quatre ans plus tôt, aux reporters de Canal+.
(L'imam Mohamed HAMMAMI, fit l'objet, le 31 octobre 2012, d'une mesure d'expulsion du territoire français. Lors de ses prêches, il avait tenu des propos ouvertement hostiles aux valeurs de la République, proféré des propos antisémites et justifié le recours à la violence et aux châtiments corporels contre les femmes.)
Grisy-Suisnes, pays de la Rose.
Sur un terrain de 1700 m2, deux mille porte-greffes ont été plantés en novembre 2011, greffés en août 2012, pour une première floraison en juin 2013, au moment de l’inauguration du site. Les visiteurs peuvent y flâner librement, admirer et comparer les couleurs, humer les différents parfums, ou tout simplement profiter d’un banc au cœur des parterres de roses. Une buvette propose café, thé ou boissons rafraîchissantes.
.jpg) |
| Photo J. Fillis (Décembre 2022) |
La gare de Grisy-Suisnes fut ouverte en 1892 sur la ligne Paris/La Bastille – Verneuil l’Etang qu'on appelait le "ligne de Vincennes" ou la "ligne V". C'est une des dernières lignes de chemin-de-fer créée à partir de Paris. La ligne fut définitivement fermée en 1964. La gare de Grisy-Suisnes était tout particulièrement désignée pour accueillir le Musée de la Rose parce que c'est à partir de ce lieu que sont parties des tonnes de roses, vendues dans la nuit sur le carreau des Halles. A partir de 1900, les trains furent appelés "trains des rosiéristes".
Grisy-Suisnes est le berceau de l'histoire de la rose dans notre région. L'Amiral Bougainville et son jardinier Christophe COCHET eurent un rôle fondateur dans cette histoire de la rose.
Bougainville, officier de marine et explorateur a effectué le premier tour du monde français entre 1766 et 1769. Le botaniste Philibert Commerson l'accompagnait au cours de cette expédition.
Commerson récolta au brésil quelques spécimens d'une très jolie fleur prélevée sur un arbuste qu'il nomma le "bougainvillier" en l'honneur de son capitaine. La fleur reçut un nom très proche avec quasiment la même orthographe : la "bougainvillée" (c'est une minuscule fleurette blanche apparaissant au milieu de ce qui semble être une fleur mais qui est un réseau de petites feuilles terminales aux couleurs intenses).
 |
| Bougainvillier (Source Pixabay) |
Conscient de la valeur de son jardinier, Bougainville l'encouragea à installer une véritable roseraie. En 1802, avec l’aide financière de Bougainville, Christophe Cochet acheta le 🔰prieuré de Vernelles où il installa sa toute première roseraie. Grâce aux recommandations de l'Amiral, la roseraie Cochet devint très réputée dans la région et connut un réel succès. La collection de roses augmenta considérablement, les pépinières de Suisnes prirent une grande extension, elles atteindront bientôt 28 hectares. (Ce développement fut également facilité par l'abandon des terres consacrées à la vigne victime du phylloxéra).
 |
| Blanc double de Coubert. Source Pixabay |
C’est Charles Cochet qui créa en 1892, une rose blanche dont les pétales fins et volumineux semblent se superposer indéfiniment. Elle est reconnue parmi les variétés de roses anciennes et a fait la célébrité de Coubert dans le monde entier sous le nom de « Blanc double de Coubert ».
Nous quittons le Chemin des Roses. Aménagé sur l'ancienne ligne entre Servon et Yèbles, il fut inauguré en 2010. (Une connexion piétonne entre le Chemin des Roses (Servon) et la Végétale (Mandres) a été inaugurée en juin 2023. (François a conduit une rando de découverte de cette connexion en janvier 2020.)
Nous dépassons le musée et la gare. Nous prenons un instant pour y observer une ancienne motrice qui, il y a plus d'un siècle, apportait vers Paris les wagons chargés de la production locale de roses.
Nous passons devant les serres de J.C. Boutcreux, encore et toujours rosiériste malgré la concurrence féroce sur le marché de la rose classique dominé par l'Afrique, l'Équateur, les Pays-Bas, et même l'Italie.
Plus loin nous empruntons le Chemin de la Justice à travers les champs d'un beau vert tendre du jeune blé en herbe . Puis le Chemin de l'Ormeau va nous permettre de rejoindre le village et les places de parking de la 🔰Place de la Mairie où nous allons pouvoir nous séparer non sans avoir pris le temps de remercier Aimé pour la belle organisation de cette intéressante rando.
Il est bien difficile de conclure cet article sans dire un mot de Madame Hégot qui a donné son nom à une des rues qui encadrent la Place de la Mairie et sans faire référence à Carine Lopes, la coiffeuse qui a installé son salon dans cette rue.
-Madame Hégot, décédée en 1873, légua à la commune un quart de sa fortune sous condition de fonder une école gratuite pour les deux sexes, dirigée exclusivement par des laïques de moralité reconnue. Le leg serait frappé de nullité si d'autres que des laïques avaient eu la charge des jeunes âmes du village. Les travaux traînèrent et ce ne fut que le 1er juin 1881 que les garçons occupèrent la première classe.
Ainsi, Mme Hégot et la municipalité de Grisy apparaissent comme des précurseurs car 1881 fut précisément l’année où Jules Ferry institua l’instruction primaire laïque, gratuite et obligatoire !
-Carine, la coiffeuse, est une personnalité tout à fait originale, célèbre pour exercer une inattendue activité "d'entremetteuse bénévole" auprès de ses clients célibataires à la recherche d'une âme sœur. Voir, ci-dessous, le reportage diffusé à ce sujet, sur France 2.
Envoyer un commentaire sur cet article.